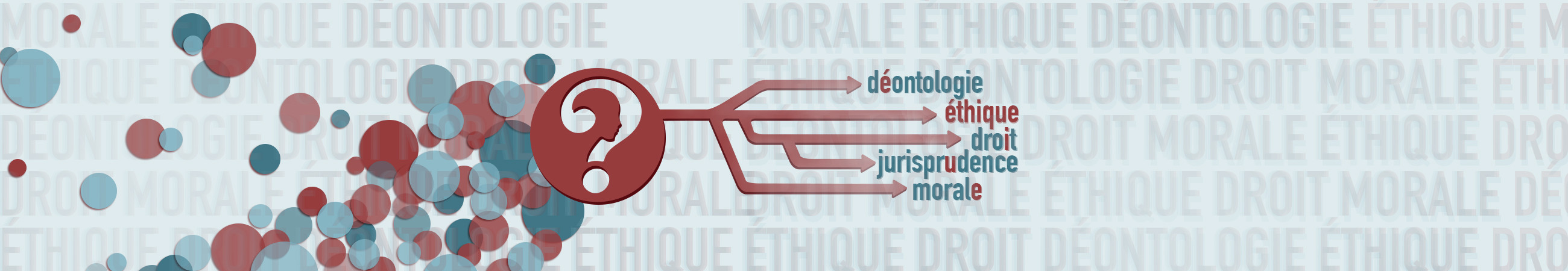L’éthique, c’est la liberté. La morale, un devoir
Aujourd’hui à la présidence de l’Institut Curie, auparavant en tant que sénateur et dans les années 1970, à la tête d’un service d’hémodialyse, le Pr Claude Huriet a envisagé l’éthique sur tous les tons. Une question l’a particulièrement animé, celle du consentement éclairé. Il l’a vécue en conscience lors des premières transplantations rénales puis l’a formalisée dans la loi. Histoire d’une vie dont l’éthique est la colonne vertébrale.
Propos recueillis par Cécile Coumau
Éthique & Cancer : Pour vous, l’éthique n’est pas le nom moderne de la morale. Qu’est-ce qui différencie ces deux notions ?
Claude Huriet : L’éthique n’est sûrement pas le nom moderne de la morale. La bioéthique liée aux sciences du vivant, aux biotechnologies, est un champ qui s’est ouvert il y a une trentaine d’années. C’est ce qui a donné à l’éthique sa modernité, même si ce concept philosophique remonte à l’Antiquité. Et, pour la définir, je citerai volontiers le philosophe Dominique Lecourt. Pour lui, l’éthique est « une réflexion, un questionnement qui porte sur des dilemmes. Face à des situations complexes, il y a un choix à faire entre plusieurs réponses qui sont toutes insatisfaisantes ». Par ailleurs, la réflexion éthique aboutit à des avis, à des recommandations. Autrement dit, il y a une liberté. D’ailleurs, la réflexion éthique doit être pluraliste et pluridisciplinaire. On éclaire des choix, on ne les impose pas. Alors que la morale, elle, s’appuie sur des considérations le plus souvent spirituelles, philosophiques ou religieuses. Et si on adhère à une morale, on s’oblige par là même à en respecter les règles. C’est un devoir.
É & C : Comme vous venez de le souligner, la réflexion éthique n’aboutit pas à des décisions mais rend des avis et des recommandations. L’éthique doit-elle malgré tout avoir une finalité pratique ?
C. H. : Oui, et c’est toute la question du passage de l’éthique à la loi. Prenons l’exemple des cellules souches ou des mères porteuses. Un comité d’éthique saisi peut en débattre pendant des heures. Il pourra, par exemple, rendre un avis non favorable aux mères porteuses. Mais, tout un chacun peut s’en moquer. C’est la liberté que j’évoquais tout à l’heure. Cependant, qu’est-ce qu’attend la société ? Des réponses concrètes. Du coup, la loi va intervenir. Le législateur a la responsabilité de dire, non pas ce qui est bien ou mal, mais ce qui est autorisé, pour la société, à un moment donné. Là, nous sommes dans le concret. Néanmoins, on en voit bien les limites car la loi s’introduit dans des domaines éminemment individuels. Concernant, par exemple, l’adoption par des couples homosexuels, c’est une question sur laquelle il est très difficile de légiférer. L’interrogation, c’est : que deviennent les enfants ? Or, nous ne savons absolument pas dire si les enfants élevés par un couple homosexuel auront moins de chance dans la vie que ceux élevés par leurs deux parents hétérosexuels. Toute la difficulté de la loi, c’est d’intervenir dans ces domaines incertains et ayant une part d’arbitraire. Légiférer sur une question éthique peut s’avérer également délicat parce que la science évolue. L’exemple parfait, c’est celui de la recherche sur les cellules souches embryonnaires. La loi de 1994 a interdit ces recherches au nom du principe suivant : l’embryon humain est une personne en devenir. Il y a eu ensuite un moratoire avec la possibilité d’avoir recours à des dérogations. Déjà, ce système pose, à mes yeux, un sacré problème : déroger à un tel principe n’était en effet pas très confortable. Depuis, les espoirs thérapeutiques ne sont plus portés par les seules cellules souches embryonnaires mais aussi en grande partie par les cellules souches adultes. Autrement dit, le dilemme éthique a changé de nature. La question des valeurs de l’embryon reste, ces valeurs ne sont pas négociables mais les termes du débat ont changé. C’est aussi pour ces raisons que les lois de bioéthique sont révisées régulièrement.
É & C : Dans quel cadre éthique avez-vous réalisé les premières transplantations rénales dans les années 1970 ?
C. H. : La loi n’existait pas mais les valeurs du consentement étaient présentes. Je me souviens encore très bien de la première greffe à Nancy. Dans la nuit, nous avons rencontré les parents d’une jeune fille accidentée pour recueillir leur consentement. La chose ne serait plus possible puisque c’est l’équipe chargée de transplanter qui a recueilli le consentement des parents. Aujourd’hui, la loi interdit que les médecins chargés de la greffe sollicitent eux-mêmes l’accord des parents. Mais, à l’époque, nous avions agi en conscience, dans le respect de la douleur de la famille et avec la volonté de ne pas exercer une pression sur elle.
É & C : Qu’est-ce que la loi qui porte votre nom, relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales, a changé pour les malades atteints de cancer ?
C. H. : Elle a marqué une vraie révolution, surtout en cancérologie pédiatrique. Demander le consentement éclairé des parents pour des recherches biomédicales, les informer de l’évolution de la maladie, des bénéfices et des risques du traitement… pour les oncopédiatres, c’était scandaleux. Les oncopédiatres étaient révulsés à l’idée d’être obligés de dire à des parents : votre enfant peut participer à un protocole de recherche clinique. Cela signifie que l’on n’est pas sûr de soi. Les parents étaient alors en droit de penser et de dire : Mais, comment, docteur vous doutez ! C’était insupportable. Maintenant, la loi de Kouchner de 2002 a mis dans la loi l’obligation d’information du malade et du consentement pour tout acte diagnostique et thérapeutique. Les temps ont changé mais cette révolution culturelle a pris du temps. Notamment parce que ces contraintes s’imposaient, à l’époque, seulement en France.
É & C : Depuis, une nouvelle loi sur la protection des personnes se prêtant à des recherches a été votée. Elle vise à simplifier les procédures et donc à faciliter les essais cliniques, qu’en pensez-vous ?
C. H. : Je pense que la loi Jardé affaiblit l’ensemble du dispositif créé par les lois initiales. Dans le texte voté cette année, le sujet dominant n’est plus la personne se prêtant à des essais mais le chercheur. Je ne vous donnerai qu’un exemple. La loi Jardé a créé des catégories dites de recherche interventionnelle sans risque majeur. Dans le cadre d’une recherche, comment peut-on préjuger de la nature du risque ? En outre, les comités de protection des personnes (CPP) n’ont jamais été évalués. Je pensais que la loi Jardé inscrirait cette obligation d’évaluation. Cela n’a pas été le cas. C’est dommage… Les CPP sont par exemple censés donner leur avis sur les publications issues des essais cliniques. Le font-ils ? Je ne suis pas sûr qu’ils en aient les moyens. Ils pourraient avoir un rôle à jouer en matière d’intégrité de la recherche. Ce qui est un enjeu majeur.
É & C : Concernant l’intégrité de la recherche, l’Institut Curie a justement organisé un colloque le 10 avril dernier. Pouvez-vous nous dire quel est le lien, selon vous, entre une recherche éthique et une recherche intègre ?
C. H. : Il y a une éthique de la recherche, qui consiste à s’interroger sur sa finalité et sur ses limites. Avec notamment une question lapidaire : tout ce qui est possible est-il permis ? Les découvertes, les progrès dans les sciences du vivant imposent tout particulièrement que l’on réfléchisse à ce que l’on fait. C’est pour cela que la bioéthique a émergé comme un concept nouveau. Les drames tels que les expérimentations humaines faites dans les camps nazis ont aussi interpellé la conscience et ont contribué à l’émergence de la réflexion éthique. Après le procès de Nuremberg, la nécessité de faire des essais sur l’homme est apparue mais à une condition absolue, celle du respect du consentement. Cette liberté de dire oui ou de dire non était le point fort de la déclaration de Nuremberg. Mais cette obligation morale ne suffisait pas. C’est pourquoi ce principe a été inscrit dans la loi de 1988, dite loi Huriet-Sérusclat. Ce principe éthique du consentement est donc ainsi devenu une obligation légale, assortie de sanction si elle n’est pas respectée. Mais, comme nous l’avons vu lors du colloque organisé par l’Institut Curie, l’intégrité de la recherche est aussi primordiale. Cela relève de la morale. Autrement dit, on ne vole pas de données, on ne les manipule pas… Et c’est parce qu’il y a cette intégrité dans la recherche qu’il y a confiance. Tout ce qui met en cause l’intégrité de la recherche porte en germe une défiance de l’opinion dans les chercheurs.
É & C : Mais a-t-on les moyens de s’assurer qu’une recherche est intègre ?
C. H. : C’est extrêmement difficile parce qu’on assiste à une explosion du nombre des publications scientifiques. En outre, les nouvelles technologies comme Internet favorisent le copié-collé. Or, le plagiat, c’est comme un vol ! Malheureusement, les moyens de lutter contre ces pratiques sont un peu dérisoires. Nous disposons essentiellement des signalements. Ce n’est même pas suffisant pour évaluer l’ampleur du phénomène. Il faudrait que, lors d’appel à projet, les porteurs de projet s’engagent à respecter les principes d’une recherche intègre. Il existe des déclarations comme celle de Singapour qui doivent être davantage connues des jeunes chercheurs.
É & C : Enfin, en quoi l’éthique (clinique et bioéthique) peut-elle jouer un rôle dans la cancérologie de demain ?
C. H. : Il me semble que les conditions dans lesquelles les traitements personnalisés vont être délivrés risquent de poser des questions éthiques. Nous constatons d’ores et déjà que, grâce à des analyses ADN, il est possible de dire à l’avance que telle personne pourra bénéficier avec de bonnes chances de succès d’une chimiothérapie, alors que telle autre, souffrant du même cancer, n’y aura pas droit. Comment les choses vont-elles être expliquées et perçues ? Il faut commencer à y penser dès maintenant. Par ailleurs, nous devons nous garder de donner de faux espoirs. Les traitements ciblés contre le cancer sont déjà très médiatisés mais il ne faut pas laisser penser que c’est fait. C’est une longue marche. L’éthique impose aussi de garder le souci de la mesure. Les espoirs sont réels mais les progrès scientifiques, l’innovation suscitent parfois une espérance un peu folle. Les interlocuteurs, même quand ils sont dans l’angoisse de la maladie, il faut les considérer comme ayant une capacité de réflexion et de discernement.