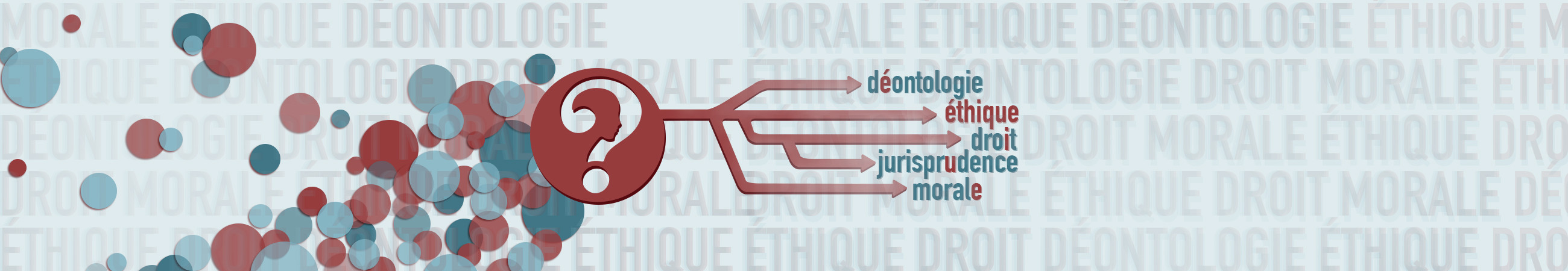M. G. est un patient de 84 ans, atteint d’un cancer prostatique avec métastases osseuses diffuses traité par hormonothérapie et radiothérapie antalgique (de D3 à D9) avec une légère amélioration sur le plan de la douleur. Il a été rapidement hospitalisé, le maintien à domicile n’étant pas compatible avec son isolement. Il a alterné entre phases de très grandes fatigues, laissant craindre le pire aux équipes, et phases de récupération. D’aspect robuste et à l’attitude décidée, il semblait peu soucieux de la dégradation de son état, voir détaché.
M.G est atteint d’une escarre sacrée très importante renvoyant l’image d’un corps usé qui se décharne, mais dont il ne se plaint pas. Malgré la douleur, il ne formule pas de demande d’aide et refuse les soins et les propositions d’antalgiques. M. G. est devenu rapidement incohérent (avec des hallucinations) et la communication avec lui est désormais difficile. Pour l’équipe de la prise en charge de la douleur se pose alors la question de savoir comment être au plus près de l’intérêt du patient.
Soulager son agonie reviendrait à décider de mettre un terme à son combat, déniant ainsi sa capacité de résistance. Apaiser sa souffrance pourrait être envisagé comme une façon de lui éviter de formuler une demande d’aide, blessante d’un point de vue narcissique. Dans ce contexte particulier, serait-il envisageable de ne pas informer le patient de l’administration d’une sédation (impliquant le risque de précipiter la survenue de la mort) ? Mais intervenir par une sédation n’irait-il pas à l’encontre de sa remarquable combativité et de sa volonté d’exister encore, malgré la souffrance physique ?
Les postulats éthiques que sont la non-malfaisance et le respect de la volonté du patient apparaissent dans ce cas comme deux valeurs opposées, à la mesure du clivage probable du patient entre soma et psyché.
La situation décrite dans cette saisine se situe dans le cadre général des questions liées à la fin de la vie de personnes atteintes de cancer. Elle soulève, sous un jour qui, pour n’être pas le plus fréquent n’est pas exceptionnel, la question de la confrontation entre l’autonomie du patient et la décision médicale. Habituellement, cette problématique est envisagée lorsqu’un malade demande à ce que sa vie soit abrégée, souvent pour ne plus souffrir. Dans le cas présent, l’équipe soignante est confrontée à un patient qui ne demande rien de tel et n’exprime aucun souhait d’être soulagé des souffrances qu’il endure, alors même qu’elle porte la responsabilité d’une prise en charge de ses douleurs. La tension éthique n’en est pas moins réelle car s’oppose le principe du respect de l’autonomie du patient à celui du devoir de soulager du mieux possible un patient en souffrance.
Autonomie du patient et bienveillance de l’équipe soignante
En premier lieu, le Comité éthique et cancer considère – et c’est une évidence absolue – qu’il ne saurait être question d’interrompre la vie de ce patient. Ce dernier n’a exprimé aucune demande en ce sens. Il a même au contraire fait comprendre sa volonté de contrôle de sa vie et de résistance face à sa maladie. Par conséquent, il n’est pas envisageable que l’équipe soignante mette en œuvre une procédure – une sédation terminale par exemple – qui puisse conduire secondairement à ce résultat, ou en accélérer l’issue.
Par ailleurs, il n’existe pas de norme quant au niveau de souffrance qu’une personne malade puisse, ou soit prête à accepter. Il relève de la liberté du patient de faire la part entre des risques éventuels, tels qu’il les perçoit, d’un traitement antalgique et la souffrance qu’il pense, à raison ou à tort, pouvoir surmonter. S’il préfère cette seconde alternative, c’est une décision qui lui incombe. Il convient de respecter sa décision, même si elle place les soignants dans une situation à l’évidence difficile. Dès lors, l’équipe soignante, dont nul ne doute de la bienveillance, doit prendre garde à ne pas chercher à abréger ses propres souffrances vis-à-vis du patient en souhaitant atténuer ou mettre fin à celles que ce dernier visiblement éprouve.
Rechercher les motivations du refus du patient
Cela étant, il est évident que les soignants peuvent et doivent intervenir à plusieurs niveaux auprès de ce patient. Tout d’abord en cherchant à mieux comprendre les ressorts de son comportement de résistance vis-à-vis tout autant de la maladie que des traitements antalgiques qui lui sont proposés. Cette résistance peut, par exemple, témoigner de sa volonté de rester actif et vigilant afin de se sentir maître de son destin, ou de garder son droit de regard sur ce qui lui est fait. Ainsi, la prise d’antalgiques pourrait lui apparaître comme un renoncement à certains de ses repères identitaires, à son combat pour la vie. Elle pourrait, en effet, signifier pour lui l’entrée dans un protocole de fin de vie, ce qu’il est en droit de refuser de toutes ses forces.
Il est évident que l’entourage du patient, ainsi que ses soignants peuvent être choqués par le corollaire de cette résistance décrite qu’est l’absence de demande d’être soulagé, voire même le refus de toute aide. Au contraire de ce qui vient d’être dit, cela pourrait être le signe d’un état dépressif le conduisant à une forme d’abandon de lui-même. Il serait donc nécessaire de chercher à connaître auprès de ce patient ce qui motive son comportement.
Il convient dans le même temps d’évaluer précisément les douleurs éprouvées par ce patient. Des outils spécifiques existent pour cela, y compris pour les personnes qui ne sont pas en mesure, ou ne souhaitent pas verbaliser, ou même s’exprimer d’autre manière. Cette évaluation permettrait de fait de mieux cerner les besoins réels du patient et donc la prise en charge qui peut lui être proposée.
Enfin, il est nécessaire d’apprécier l’incohérence décrite et son étiologie possible. S’agit-il d’une confusion mentale relevant d’une thérapie qui permettrait le retour à un dialogue possible ? S’agit-il d’une sorte de carapace qu’il se crée afin de résister à l’ingérence de la médecine dans sa vie ? Est-il possible qu’elle résulte directement des douleurs éprouvées ? Arrive-t-on, dans un tel cas, aux limites de ce que la technique médicale peut évaluer 1? Dans tous les cas, il est important de parvenir à évaluer le degré d’altération de son état de conscience, et de déterminer si celle-ci est permanente ou discontinue.
Quel compromis parmi les différentes alternatives ?
Une fois ces évaluations réalisées, il convient de tout faire pour informer le patient de sa situation telle qu’elle est appréhendée par l’équipe soignante et de lui expliquer de façon aussi accessible que possible la prise en charge qui lui est proposée, et quels en sont ses objectifs. Il est, par exemple, essentiel de lui faire comprendre, si ce n’est admettre que le but premier de l’équipe est de le soulager, ainsi que d’améliorer sa qualité de vie et donc de lui redonner le sentiment d’un meilleur contrôle sur sa vie (si tel est bien le ressort qui l’anime).
L’information délivrée ne doit toutefois pas s’inscrire dans une démarche de « tout ou rien » ; il ne s’agit donc pas de se limiter à savoir si le patient donne ou pas son consentement à la prise en charge proposée. L’important est de parvenir à faire en sorte qu’il puisse, le plus en conscience possible, faire un choix parmi les différentes alternatives envisageables.
Un choix est par définition un compromis dont les termes sont entre les mains du patient. Ce à quoi le dialogue avec l’équipe soignante doit parvenir, au-delà de l’information, de l’éclairage sur sa situation, est de permettre au patient d’exprimer quel compromis lui serait acceptable et d’adapter son accompagnement en conséquence.
Dans l’éventualité où, une fois toutes les évaluations réalisées et le dialogue engagé, il serait établi que le patient serait dans l’incapacité d’exprimer ses choix, le dilemme éthique resterait entier. Entier, mais déplacé vers le questionnement éthique particulièrement difficile de la prise de décision au nom de - et pour la personne en incapacité de le faire.
Les directives anticipées, un dispositif encore trop méconnu
In fine, il convient de souligner à quel point il aurait été utile que l’équipe soignante dispose de directives anticipées rédigées par ce patient au début de sa prise en charge. Elles auraient permis à l’équipe de ne pas se retrouver dans la situation d’incertitude qui est la sienne sur l’attitude à adopter. Dans le cas présent, l’équipe indique qu’une information sur les directives anticipées est systématiquement remise à l’entrée dans l’établissement et les services. C’est sans doute également le cas dans nombre de centres hospitaliers à l’heure actuelle. L’exemple de ce patient montre cependant qu’une simple démarche d’information est à l’évidence insuffisante. Les directives anticipées sont malheureusement un dispositif encore beaucoup trop rarement utilisé. Il conviendrait de s’interroger en profondeur sur les raisons de cet état de fait. Face à la difficulté que représente la rédaction d’un document dans lequel le pire peut – et doit être envisagé -, le statut accessoire de ce document dont la qualification de « directives » est probablement abusif dans l’état actuel de la législation puisqu’il n’a aucune force contraignante quant aux suites à lui donner, peut limiter la motivation des patients à effectuer cette démarche.