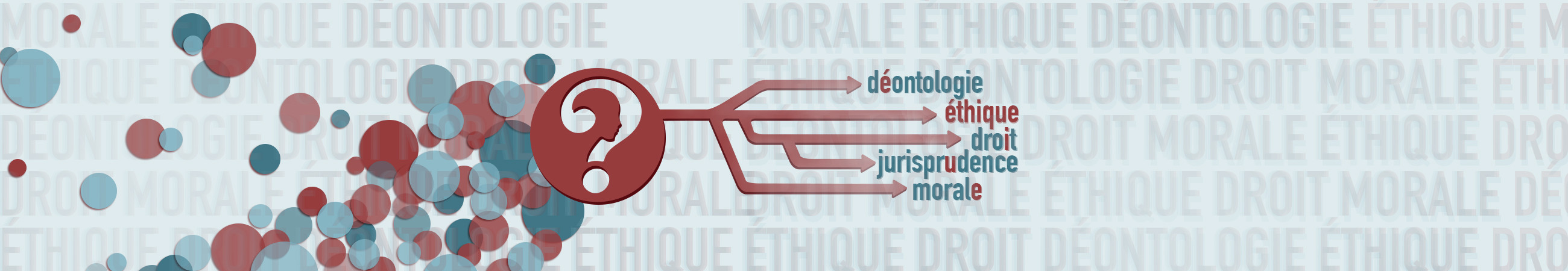Le principe de précaution ne traduit pas une peur du progrès
Créé il y a vingt-huit ans à l’occasion de la première naissance in vitro, le CCNE jongle avec les questions éthiques touchant aux sciences de la vie et de la santé. Refusant tout à la fois de répondre frénétiquement aux questions éthiques ponctuelles que soulève l’actualité mais aussi d’analyser les progrès scientifiques avec trop de recul, son président, le Pr Alain Grimfeld, nous indique son chemin de crête.
Propos recueillis par Cécile Coumeau
Éthique & cancer : Pouvez-vous nous donner votre définition de l’éthique et nous dire en quoi elle se distingue d’une valeur morale ?
Alain Grimfeld : J’adopte volontiers comme définition de l’éthique la formule suivante : l’exercice d’une morale active, qui évolue entre compassion et raison. Ce qui différencie complètement l’éthique de la morale, c’est qu’avec “valeur morale” on sous-entend beaucoup d’aspect contemplatif, beaucoup de raisonnement sans forcément de recommandations, beaucoup de discours un peu incantatoires. Par ailleurs, la morale est par essence intemporelle. Alors, bien sûr, certains diront qu’elle est du coup universelle et constamment d’actualité. Mais, quand on analyse les documents moralisateurs, on se rend bien compte qu’ils ne sont pas forcément adaptés à l’évolution des connaissances, notamment dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. C’est là précisément un point fondamental : l’éthique doit suivre l’acquisition des connaissances. Or, les progrès sont, dans le domaine considéré, de nature exponentielle.
É & C : La naissance du CCNE illustre cette volonté de suivre les progrès dans le domaine des sciences de la vie et de la santé ?
A. G. : Effectivement, le Comité consultatif national d’éthique français est le premier comité national au monde, dans les sciences de la vie et de la santé, à avoir vu le jour, en 1983. Il a été créé à l’occasion de la naissance d’Amandine, le premier “bébé éprouvette”. François Mitterrand a souhaité créer ce comité, car il estimait que la science évoluait plus rapidement que l’esprit humain, et que cela posait et poserait des questions éthiques majeures.
É & C : Vous êtes donc né d’une actualité. Mais comment faites-vous pour ne pas sur-réagir à chaque actualité ?
A. G. : C’est effectivement une question centrale. En fait, nous faisons en sorte que notre réflexion ne se contente pas de suivre les découvertes mais qu’elle accompagne, voire anticipe, autant que faire se peut, les résultats des recherches en cours et leurs futures applications. C’est très ambitieux et peut-être présomptueux, mais prenons un exemple : certains chercheurs nous disent que demain il sera possible de vivre jusqu’à 130 ans, voire 150 ans, et qu’il faut se lancer dans cette voie. La réflexion éthique immédiate consiste à dire : mais pourquoi repousser l’échéance de la mort ? En a-t-on peur ? La mort fait partie du cycle de la vie. La question posée est : tout ce qui est techniquement réalisable dans le domaine du vivant est-il pour autant autorisable ?
É & C : Vous serez d’accord que l’éthique est un outil de démocratie sanitaire. Pourtant, le CCNE ne peut pas être saisi par un simple citoyen. N’est-ce pas une faiblesse ?
A. G. : Je suis en effet entièrement d’accord avec le fait que la réflexion éthique fait avancer la démocratie sanitaire. Mais, contrairement à ce que vous pensez, le citoyen a toute sa place dans notre organisation et il va l’avoir de plus en plus. En fait, le CCNE peut être saisi par des institutions, que sont la présidence de la République, les assemblées parlementaires, les membres du gouvernement ou encore des établissements publics et des fondations ayant pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé ; mais nous pouvons aussi nous autosaisir de toute question posée par l’un de nos membres mais aussi par un citoyen. C’est ce qui garantit notre indépendance et nous permet d’être à l’écoute des préoccupations éthiques de la société. Cela dit, vous avez raison, le CCNE est mal connu, insuffisamment en tout cas étant donné l’intérêt des Français pour ces questions. C’est pourquoi je me suis battu pour que l’arrêté constitutif des espaces de réflexion éthique régionaux, dont les missions sont comparables à celles du CCNE au niveau régional, et dont la création était déjà prévue dans la loi de bioéthique de 2004, soit enfin signé.
Nous avons absolument besoin de toute la richesse actuelle développée dans ce pays en ce qui concerne la réflexion éthique. S’il y a une chose que je voudrais que l’on retienne de mon mandat, c’est bien la collaboration, élevée au niveau institutionnel, avec ces espaces régionaux et avec les comités d’éthique locaux. Toujours dans un souci de partager la réflexion éthique avec le plus grand nombre, je souhaite que s’étende et se développe de la même manière la collaboration avec d’autres comités d’éthique, comme celui de la Ligue contre le cancer.
É & C : Pensez-vous ainsi, à l’avenir, renforcer l’impact de vos avis ?
A. G. : Il est vrai que certains de nos avis ont été mal compris, et n’ont donc pas eu l’impact souhaité. Je pense notamment à notre avis sur la recherche sur l’embryon humain. Dans cet avis, nous posions plus de questions que nous n’y répondions. Étant donné l’état des connaissances, il nous semblait en effet plus opportun d’aider la population à se poser les bonnes questions, en toute humilité, plutôt que de recommander telle ou telle recherche, d’interdire ou autoriser telle autre. Nous ne pouvons pas proposer des kits à penser, appuyer sur un bouton pour obtenir une réponse éthique. Il faut expliquer à la population que nous sommes en permanence en situation d’incertitude scientifique. En cela, les comités locaux et régionaux vont nous être d’une grande aide.
É & C : Cette incertitude permanente, intrinsèque aux sciences de la vie et de la santé, n’est-elle pas une incitation à user et abuser du principe de précaution et donc à exagérer les dangers qui nous menacent ?
A. G. : Non, je ne le crois pas, mais je pense qu’il faut bannir le terme même de principe de précaution. Mieux vaut parler de méthodologie de prise de décision publique en situation d’incertitude scientifique. Qu’est-ce que cela change, allez-vous me dire ? Et bien, en fait, dès que l’on emploie le mot “précaution”, on pense immédiatement [A1] “prudence”, “moratoire”, voire “parapluie”. L’application du principe de précaution ne traduit en aucune manière une peur du progrès. C’est exactement l’inverse. Nous avons même l’absolue nécessité d’avancer, en flanquant toute décision prise au nom de ce principe, de programmes de recherche. Mais il est vrai que ce fameux principe de précaution a été un peu brandi à tort et à travers. Lors de la pandémie de grippe A H1N1, le ministre de la Santé de l’époque a justifié ses décisions au nom du principe de précaution. C’est une incompréhension fondamentale. La vaccination est un exemple caractéristique de prévention, et non de précaution, puisqu’on a identifié le danger, qu’on connaît les risques et que nous avons les moyens de les prévenir. Cela étant, à propos de la vaccination H1N1, certains ont évoqué le danger de déclencher des syndromes de Guillain-Barré. Là, il est possible de faire jouer le principe de précaution. À l’intérieur même de la prévention, il peut donc y avoir une part d’incertitude relevant du principe de précaution.
É & C : Lors de ces derniers mois, l’actualité a relancé le débat éthique sur la fin de vie, et la fameuse dichotomie entre euthanasie active et passive a refait surface. Est-ce que vous récusez ce terme ?
A. G. : Absolument, nous le récusons, car il porte à confusion. Lors de la remise de notre avis sur la fin de vie, cela laissait à penser que le Comité consultatif national d’éthique autorisait l’euthanasie, sans le dire et dans des circonstances pas claires. Au nom de l’un de nos principes fondamentaux qu’est le respect intangible de la dignité humaine et de la vie, nous ne pouvions pas préconiser la suppression de la vie, qu’elles que soient les circonstances.
É & C : Malgré tout, depuis la parution de votre avis, la loi Leonetti a été promulguée et cette dichotomie euthanasie passive et euthanasie active perdure. La loi ne l’entretient-elle pas en autorisant les médecins à donner des médicaments qui soulageront la douleur mais risquent de précipiter le décès ?
A. G. : J’entends bien les critiques selon lesquelles le CCNE mais aussi la loi Leonetti joueraient sur les mots, avec une forme d’hypocrisie. Pour lever cette ambiguïté, il faudrait tout d’abord que tous les acteurs de soins connaissent ce texte de loi. Et le message qu’il faut faire passer dans la société est qu’il y a une énorme différence entre interrompre brutalement la trajectoire de vie et l’accompagner jusqu’à la fin. Par ailleurs, j’ai pu constater – notamment de par mon expérience personnelle de praticien – qu’en France trop de soignants sont encore frileux vis-à-vis des médicaments pouvant soulager la douleur. Je suis en outre très attaché au développement de ce que l’on appelle le “care”, et particulièrement à la démédicalisation de la fin de vie. Il est ignoble de constater que la majorité des Français terminent leurs jours à l’hôpital. Pour que les fins de vie se déroulent dans de bonnes conditions à la maison, je me bats pour que l’on transfère le budget de l’assistance hospitalière de fin de vie vers une assistance médicale à domicile. Vous savez, les réanimateurs ne demandent que cela…
É & C : Cette démédicalisation de la fin de vie, que vous appelez de vos vœux, ne doit-elle pas s’appliquer à d’autres domaines ? Autrement dit, l’éthique n’est-elle pas, elle aussi, un peu monopolisée par les médecins et les scientifiques ?
A. G. : C’est effectivement une critique récurrente. Je l’entends aussi concernant l’Afssaps, dont je suis le président du conseil scientifique. Mais je tiens à signaler que la société civile est très bien représentée au CCNE. Les rapporteurs de chacun de nos avis sont toujours deux personnalités : un scientifique et un philosophe. Non seulement les médecins ne sont pas en surnombre mais, en plus, ils tiennent à ce que le raisonnement médical ne constitue pas la pensée dominante. D’ailleurs, nos sujets de réflexion ne portent pas que sur la santé. Il est vrai que nous avons beaucoup travaillé sur la question de l’assistance médicale à la procréation et sur le don d’organe mais nous nous ouvrons à un nouveau champ, celui des neurosciences. Et je suis d’ailleurs très impatient de voir paraître notre prochain avis sur l’imagerie cérébrale fonctionnelle. Les progrès sont tels dans ce domaine qu’ils permettent de mieux comprendre le développement de certaines maladies neuropsychiatriques ou de certains comportements délictueux. Mais l’imagerie cérébrale fonctionnelle pourrait aussi constituer un outil de catégorisation de la population non malade, ce qui en fait un sujet de débat éthique de première importance.