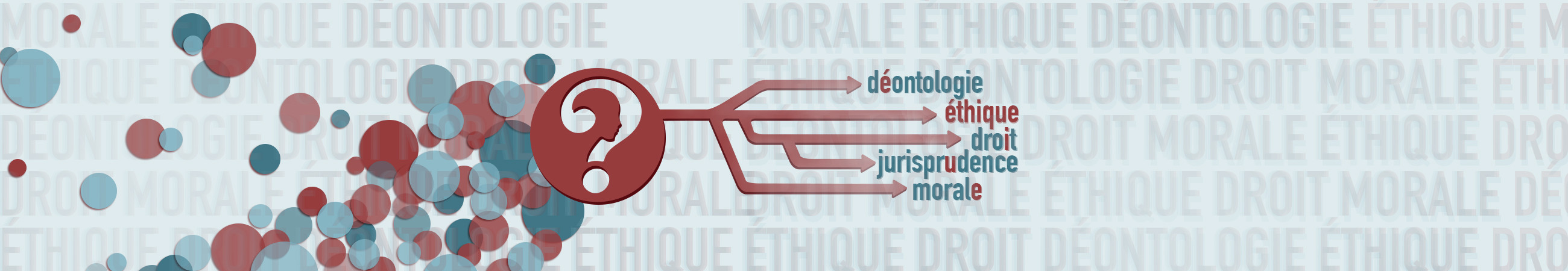Les considérations médico-économiques s’imposent de plus en plus dans notre environnement. Les Britanniques se sont engagés dans ce processus en intégrant les Qaly (“Quality Adjusted Life Year” ou “année de vie ajustée par sa qualité”) dans l’évaluation du service médical rendu par certains médicaments. Ainsi, en considérant qu’une année de vie est estimée à 50 000 euros, les Britanniques refuseront désormais de prendre en charge dans le cadre du NHS (National Health Service) un médicament dont le coût annuel serait supérieur à ce montant, modulé par les Qaly, c’est-à-dire la qualité de vie des mois ou années apportés par ce médicament. Si cette qualité de vie est diminuée, le montant de 50 000 euros est diminué d’autant. C’est par ce raisonnement que les Britanniques ont rejeté récemment le remboursement de nouvelles molécules anticancéreuses dans des indications telles que le cancer du rein dans sa forme métastatique, estimant que leur prix était excessif et que le coût qu’elles représenteraient pourrait être plus utile ailleurs. En revanche, ces molécules ont été mises sur le marché français. Cette notion de limitation du coût d’un traitement annuel va surtout pénaliser le progrès incrémental grâce auquel s’est fait l’essentiel des progrès thérapeutiques récents en cancérologie. Les nouvelles thérapeutiques n’apportent en effet, le plus souvent, que des gains modestes en termes de survie, mais ces gains ajoutés les uns aux autres finissent par allonger très significativement les temps de survie.
Cette tendance va-t-elle s’imposer en France ? Est-elle éthiquement acceptable dans la mesure où la collectivité pourrait sans doute contribuer davantage au financement de la santé, justement pour permettre de conserver un système solidaire donnant le maximum de chances à chaque Français ? Est-elle éthiquement acceptable dans la mesure où elle est susceptible de bloquer la dynamique de l’innovation thérapeutique, les entreprises du médicament étant susceptibles de refuser d’investir dans de très coûteux programmes de recherche et développement si leurs chances de commercialiser ces innovations incrémentales diminuent très sensiblement ?
La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût. De fait, les dépenses liées à la santé sont en progression constante depuis plusieurs décennies en France. Cela conduit à poser la question de l’utilisation des ressources disponibles, le débat étant le plus souvent focalisé sur le thème de la “maîtrise des dépenses”. L’accroissement de ces dépenses est lié en partie aux progrès médicaux, qu’il s’agisse de la mise sur le marché de médicaments onéreux, du fait de leur caractère dit “innovant”, ou de la mise à disposition de nouvelles techniques opératoires, de biologie ou d’imagerie.
Le champ de la cancérologie est particulièrement concerné par l’augmentation des dépenses de santé en raison des progrès importants obtenus ces deux dernières décennies, avec en particulier les médicaments dits “de biothérapie” (ou thérapies ciblées) et le recours croissant aux techniques de génomique et de génétique. Parmi les innovations thérapeutiques récentes, il est nécessaire de distinguer celles qui ont radicalement changé le devenir des patients atteints de certaines pathologies – c’est le cas par exemple de l’imatinib dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique – de celles apportées par des médicaments au bénéfice plus modeste mais néanmoins certain. Dans ce second cas, il convient d’avoir présente à l’esprit la notion de “progrès incrémentaux”, c’est-à-dire la succession de progrès limités mais qui, au final, peuvent modifier de façon conséquente le pronostic d’une maladie et le devenir des personnes qui en sont atteintes. De nombreuses améliorations importantes pour la prise en charge de malades ont été apportées par ces progrès incrémentaux.
Des coûts en augmentation
Le poids financier des innovations thérapeutiques récentes connaît une croissance importante. Cela a conduit les autorités de santé à inscrire depuis 2004 certaines molécules onéreuses sur une “liste en sus des GHS1”, qui permet leur remboursement aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sous réserve que ces établissements respectent les référentiels de bon usage définis conjointement par l’Institut national du cancer (INCa) et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps)2. L’accroissement des dépenses est lié pour partie à une augmentation du nombre de patients traités par chimiothérapie : + 24 % sur les cinq dernières années selon un rapport de l’INCa, qui note que « le nombre de malades traités par chimiothérapie croît ainsi plus vite que le nombre de nouveaux malades (deux fois plus) : les indications de chimiothérapie concernent donc une proportion croissante de malades atteints de cancers3 ». Parallèlement, le coût des médicaments anticancéreux de la “liste en sus” est passé de 474 millions d’euros en 2004 à plus d’un milliard d’euros en 2009 dans les établissements publics. Au sein de ces dépenses, 57 % des coûts étaient concentrés en 2009 sur des molécules de biothérapie, quatre d’entre elles (bevacizumab, rituximab, trastuzumab et cetuximab) représentant la quasi-totalité des coûts liés aux médicaments de biothérapie. De nombreux autres médicaments visant une cible biologique des cellules tumorales sont en cours de développement. Il est donc attendu que le nombre de médicaments de biothérapie mis à la disposition des prescripteurs continue d’augmenter, alors que le prix de ces molécules atteint des niveaux jamais vus jusque-là4.
Quel choix pour les dépenses de santé ?
Dans ce contexte, il apparaît légitime de s’interroger sur l’usage des molécules onéreuses en cancérologie et sur les choix inhérents aux contraintes imposées par le coût de ces médicaments et, plus globalement, par celui de la prise en charge des personnes atteintes de cancer. Ne pas le faire serait contraire à l’éthique, puisqu’il s’agit ici de questionner l’accès aux soins selon les principes d’équité et de solidarité qui prévalent en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) l’énonce ainsi dans son avis n° 101 de juin 2007 : « Les conséquences d’une absence de choix font toujours basculer la répartition des soins au détriment des plus vulnérables. C’est bien l’évolution que nous craignons actuellement ; elle témoigne du caractère inéthique de l’absence de choix.5 »
Une première question est de savoir quelle est la part des ressources qu’un pays comme la France est disposé à consacrer à son système de santé. Il est évident que ces ressources sont par essence finies. Cependant, ainsi que l’indique le CCNE dans son avis n° 57 de mars 1998, la science économique « n’a pas dit que pour les activités de santé et elles seules il existe un nombre d’or, une limite au-delà de laquelle il y aurait lieu de restreindre ses efforts. Il n’est pas question de chercher à atteindre un niveau précis, fixant la part de l’effort collectif ou des efforts individuels qu’il est légitime de consacrer à la préservation de la santé. Ou plutôt, il n’est pas de fondement scientifique à l’existence d’une telle limite ; elle est le résultat, à un moment donné et au vu de l’histoire, d’un choix qui lui-même est une étape d’une évolution sociale, économique et politique6 ». Selon des données réunies par la Banque mondiale, la France consacrait 11,7 % de son produit intérieur brut (PIB) à ses dépenses de santé en 2009 (10,1 % en 1999), la moyenne au sein de l’Union européenne étant de 10,3 % (8,6 % en 1999), dont 11,3 % en Allemagne et 9,3 % au Royaume-Uni. Ceux qui dépensent le plus pour leur système de santé sont les États-Unis avec 16,2 % de leur PIB (13,3 % en 1999), alors que le Japon consacre 8,3 % de son PIB à ses dépenses de santé (7,5 % en 19997). Les variations selon les pays, à situation économique relativement comparable, peuvent donc être importantes et ne préjugent pas nécessairement d’une corrélation entre le niveau des dépenses et l’efficacité du système de santé ; c’est par exemple au Japon que l’espérance de vie est le plus élevée au monde alors que ce pays dépense presque deux fois moins pour son système de santé que les États-Unis.
Un débat démocratique et transparent
Ces variations confirment également que, comme le soulignait le CCNE dans son avis précité de 1998, la part des dépenses allouées à la santé relève avant tout d’un choix de société. Ainsi, rien n’empêche un État de décider d’augmenter cette part s’il estime que cela est nécessaire au bien-être et à la préservation de la santé de sa population. Un tel choix relève d’un débat démocratique devant impliquer l’ensemble des représentants de la société, non seulement le corps politique, mais aussi les professionnels de santé et la société civile, en particulier les patients et leurs proches, afin que le débat ne soit pas, ou le moins possible, biaisé par la défense d’intérêts particuliers et par le corporatisme.
Un tel débat nécessite au préalable que les coûts liés au système de santé fassent l’objet de la plus grande transparence possible, afin que les choix soient guidés avant tout par des raisonnements éclairés. À ce titre, l’opacité qui prévaut depuis des décennies quant au prix des médicaments est parfaitement condamnable. D’une part, le discours des laboratoires pharmaceutiques, qui consiste à dire que le prix d’un médicament tient compte non seulement du coût de production mais aussi des investissements en termes de recherche, investissements qui incluent le développement du médicament concerné mais aussi l’ensemble des recherches sur des molécules dont la plupart seront abandonnées en cours de route, n’est étayé par aucune donnée chiffrée précise et évaluable8. D’autre part, il est connu que les négociations entre les firmes et le Comité économique des produits de santé (Ceps) pour fixer le prix d’un médicament précis intègrent d’autres aspects que la seule détermination du prix proprement dit, et que les termes de ces négociations sont tout sauf transparents. Certes, même si la santé n’est pas un bien comme les autres, il n’est pas possible d’ignorer que l’industrie pharmaceutique fonctionne comme toutes les autres industries, c’est-à-dire selon les règles de l’économie capitaliste, et que par conséquent elle vise à maximiser son profit ; cela n’est pas en soi condamnable, sauf à remettre en question le capitalisme dans son ensemble. Sachant que, par ailleurs, les profits réalisés par l’industrie pharmaceutique lui servent, pour partie, à investir dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments ; nombre des innovations thérapeutiques résultent de ces investissements de l’industrie pharmaceutique. Cependant, parce que la santé n’est justement pas un bien comme les autres, et que les contraintes économiques obligent à des choix, il n’est plus possible d’accepter l’opacité persistante dans laquelle les populations et même, dans une certaine mesure, les États sont maintenus par l’industrie pharmaceutique quant aux prix des médicaments qu’elle propose. Ainsi l’explique le CCNE dans son avis n° 101 de 2007 précité : « La loi du marché s’impose toujours. Simplement, le payeur pourrait beaucoup plus argumenter sur la fixation du prix dans la mesure où il a le monopole de la demande.9 »
Éthique et rationalisation
La part des ressources consacrées à la santé n’est qu’un des éléments du débat. Il convient également d’interroger l’utilisation elle-même de ces ressources puisque, quel que soit leur niveau, elles sont dans tous les cas limitées. Tout gaspillage des ressources est contraire à l’éthique puisque cela nuit aux individus et à la collectivité. Par ailleurs, ce qui est dépensé pour un type de soin ou un type de maladie ne peut l’être pour d’autres ou ne peut être consacré à d’autres domaines de la santé, comme la prévention, dont l’importance est pourtant cruciale et vis-à-vis de laquelle la France souffre d’un retard patent.
Le respect de l’équité rend nécessaire une démarche de rationalisation des dépenses. Cette démarche est d’autant plus importante qu’elle doit permettre d’éviter un rationnement des soins, qui, comme le souligne le CCNE dans son avis n° 101, « peut mettre en péril les principes mêmes de la protection sociale. Ne pas tenir compte du caractère fini des ressources disponibles entraînerait forcément une restriction de l’accès aux soins qui serait aléatoire ou discriminatoire pour certaines populations de patients, avec des conséquences éthiques majeures10 ».
Ce faisant, il convient de se défier d’une approche exclusivement budgétaire, fondée uniquement sur un niveau de dépense et qui à bien des égards est par trop restrictive. Une véritable approche économique tient compte tout autant des coûts engendrés par l’activité du système de santé que des bénéfices induits par cette même activité ; bénéfices à l’échelle individuelle, pour les malades et leurs proches, mais aussi pour les professionnels qui tirent leurs revenus de leur activité au sein du système de santé ; bénéfices à l’échelle collective par l’amélioration du niveau de santé de la population, par l’activité économique liée au système de santé, mais aussi par la cohésion sociale que procure un système fondé sur l’équité et la solidarité. Malheureusement, ces bénéfices sont rarement pris en compte et n’apparaissent pas dans une approche purement budgétaire (ou comptable). Dès lors que les dépenses et les bénéfices sont mis en balance, il devient évident qu’économie et éthique ne sont pas incompatibles et même que l’éthique peut guider les choix économiques.
Des critères pour choisir
Pour cela, il convient de questionner les critères qui doivent présider à la rationalisation des soins et des dépenses afférentes, en particulier celles liées aux médicaments onéreux. Pour le Comité, ces critères se fondent avant tout sur l’évaluation, que celle-ci concerne les compétences, les pratiques ou les produits de santé. Certains de ces critères sont d’ores et déjà à l’œuvre concernant les compétences et les pratiques :
– La prescription des médicaments anticancéreux ne peut être réalisée que par des médecins spécialistes possédant une qualification ordinale en cancérologie (DES d’oncologie médicale ou de radiothérapie, DESC de cancérologie).
– La prescription des médicaments anticancéreux ne peut être réalisée qu’au sein d’un établissement de santé autorisé par une Agence régionale de santé (ARS) sur la base de critères d’agrément visant à garantir la qualité des soins et de la prise en charge. Ces critères prévoient notamment l’accès au dispositif d’annonce pour les nouveaux patients, l’accès à une concertation pluridisciplinaire pour chaque patient, la remise d’un programme personnalisé de soins aux patients, l’utilisation des référentiels de bonnes pratiques.
– Le remboursement des molécules onéreuses aux établissements de santé est assujetti au respect des référentiels de bon usage (RBU).
La pertinence de ces critères est évidente. Il conviendrait toutefois qu’ils soient complétés par d’autres mesures d’évaluation. Le Comité suggère notamment que :
– les règles d’arrêt des traitements, en particulier des molécules onéreuses, fassent l’objet de référentiels spécifiques ou soient intégrées dans les référentiels existants ;
– un recueil d’informations soit organisé pendant et après les traitements, jusqu’à l’éventuel décès de chaque patient, afin de contribuer à l’évaluation dans la pratique courante du bénéfice et des risques associés aux médicaments anticancéreux, en particulier pour les molécules onéreuses. Ce recueil d’informations viendrait ainsi compléter l’évaluation initiale du rapport bénéfice/risque de tout nouveau médicament telle qu’elle est mise en œuvre lors des demandes d’autorisation de mise sur le marché et des éventuelles extensions d’indication qui suivent celles-ci ;
– une estimation du rapport coût/bénéfice de chacune des molécules onéreuses soit établie et régulièrement réévaluée, puis communiquée aux prescripteurs. Ainsi que le souligne le CCNE dans son avis n° 101 de 2007, « l’estimation du rapport coût/bénéfice doit prendre la même importance dans l’esprit des praticiens que celle de la balance bénéfices/risques11 ».
Recommandations
L’exigence d’une démarche éthique guidant la rationalisation des soins conduit le Comité à refuser toute démarche visant à quantifier la valeur d’une année de vie, telle que celle proposée à travers le critère de coût par Qaly. Le Qaly est le nombre d’années de vie gagnées grâce à un traitement corrigé par la qualité de vie. Cette approche ne fait pas consensus en raison de plusieurs défauts de principe en tant que critère de choix collectif. Elle favorise clairement le principe d’utilité pour la société au détriment du principe d’égalité et de soutien aux patients qui nécessitent le plus d’aide ; elle conduit ainsi à être discriminatoire envers les personnes âgées, handicapées ou en situation de grande précarité sociale. De plus, les études réalisées jusqu’à présent montrent que le Qaly déterminé par un médecin diffère souvent pour un même patient du Qaly estimé par une infirmière ou par le patient lui-même. Enfin, la définition de la qualité de vie reste difficile à établir. Elle inclut des dimensions physiques, psychologiques et sociales pour une part objectives mais en partie également subjectives, donc plus difficilement quantifiables, sachant que de surcroît ces différentes dimensions sont évolutives dans le temps pour un même individu.
Par ailleurs, le Comité éthique et cancer considère que la démarche de rationalisation des soins doit s’accompagner d’un effort de pédagogie particulièrement important engagé auprès des patients et de leurs proches, mais aussi de la société dans son ensemble. Le caractère onéreux des molécules de biothérapie tend à entretenir l’idée, voire l’illusion, que parce qu’ils sont chers ces médicaments seraient par définition efficaces pour tout un chacun susceptible d’en avoir besoin. Par essence, ces médicaments ne peuvent être actifs que si la cible moléculaire qu’ils visent est présente au sein des cellules tumorales. Cela suppose au préalable de rechercher cette cible par un test adéquat et de conditionner la prescription au résultat de ce test. Ce type de démarche est l’un des fondements de ce que l’on appelle la “médecine personnalisée” en cancérologie ; cette notion demande à être particulièrement bien explicitée, notamment auprès des patients afin qu’ils comprennent pourquoi un médicament de biothérapie peut ou ne peut pas leur être prescrit, et que cela est totalement indépendant de son prix. D’une manière générale, le coût des traitements n’a évidemment pas à intervenir dans le dialogue singulier entre un malade et son médecin.
Pour autant, la prise en charge d’un malade atteint de cancer ne se réduit pas nécessairement à la prescription de médicaments. Le Comité renvoie à son avis n° 13 du 3 janvier 2011, où il est dit notamment que « la prise en charge médicale proposée et l’objectif poursuivi au travers de celle-ci doivent être adaptés à la situation du patient, au fur et à mesure de l’évolution de sa maladie. L’ensemble des traitements et des soins successivement proposés s’inscrit nécessairement dans une forme de continuité. Dès lors, il peut arriver un temps où les traitements spécifiques sont devenus inutiles, voire néfastes compte tenu de leurs répercussions négatives sur la qualité de vie. L’arrêt de ce type de traitement doit alors pouvoir s’envisager12 ». Ne pas prescrire un ou des médicaments qui seraient, au regard de la situation d’un malade, inutiles, voire néfastes pour la qualité de vie de celui-ci en raison des éventuels effets indésirables associés, participe de la rationalisation des soins tout en respectant la déontologie médicale vis-à-vis de ce malade et l’éthique des principes d’équité et de solidarité.
Conclusion
Le Comité éthique et cancer considère que, par une organisation accrue de l’évaluation des pratiques et des produits de santé, il est possible de parvenir à concilier exigences éthiques et considérations financières, afin de permettre de préserver un système de santé fondé sur l’équité et la solidarité. Une approche “utilitariste” qui privilégierait la société au détriment des individus, en particulier des plus défavorisés, serait contraire au respect de la dignité humaine et de la justice, et serait par conséquent non éthique. Si néanmoins les contraintes budgétaires doivent conduire à définir des choix parmi les priorités de santé et l’utilisation des ressources disponibles, cela relève d’un débat démocratique engageant l’ensemble de la société, dont les patients et leurs proches. Ce débat nécessite, pour que les choix soient véritablement éclairés, la plus grande transparence sur les coûts, en particulier ceux des médicaments ; il est indispensable de mettre un terme à l’opacité qui prévaut sur ceux-ci depuis trop longtemps. Un tel débat témoignerait de la réalité d’une véritable démocratie sanitaire s’appuyant, à l’échelon individuel, sur une tout aussi véritable citoyenneté sanitaire.