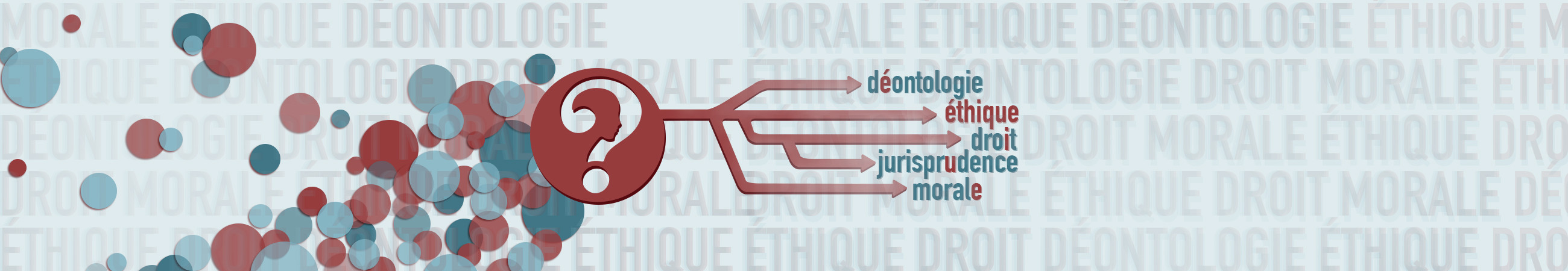Notion de la vie courante que l’on retrouve également dans les textes de loi, le consentement est évoqué dans de nombreuses situations, notamment dans le domaine des rapports hommes-femmes, du travail ou de la santé. En éthique médicale et en droit des malades, il est question aujourd’hui du consentement libre et éclairé du patient, avant tout acte de soin ou traitement. Entretien avec la philosophe Geneviève Fraisse, qui a accepté d’élargir à la médecine son champ de réflexion sur le consentement.
Éthique & Cancer : Pourquoi la notion de consentement prend-elle de plus en plus de place dans notre société ?
Geneviève Fraisse : La notion de consentement sert effectivement de catalyseur à de très nombreuses discussions, à tel point qu’elle prend la valeur d’un argument politique, comme dans les débats sur le port du foulard ou sur la prostitution. Je pense que c’est le contexte politique, français et mondial, qui explique la montée en puissance de ce mot sur la place publique. Sur le court terme, elle est due à la campagne présidentielle de 2007 : près de deux ans après l’élection du nouveau président, le « non à la soumission » est clairement prononcé sur de nombreuses questions, comme le rappellent les dernières grèves. Le fait de consentir deviendrait alors le contraire de la résistance. À plus long terme, je crois que cette demande se fait autour de la discussion sur la possibilité d’un autre monde. Ma génération est représentative de cette possibilité, avec les utopies, le socialisme au gouvernement, l’altermondialisme… Mais après la chute du mur de Berlin, aucun autre monde ne semble possible. La solution est d’assumer le fait de consentir, avec comme seule possibilité de subvertir les choses de l’intérieur. Aujourd’hui, la crise du capitalisme repose la question d’un autre monde possible.
É & C : La question du consentement est souvent posée à travers celle de son authenticité. Vous estimez que ce n’est pas la bonne façon de procéder. Pourquoi ?
G. F. : Dans les débats autour du port du foulard et de la prostitution, l’argument du consentement est utilisé de deux façons. D’un côté, certains remettent en cause son authenticité, le considérant comme le fruit de la misère (prostitution) ou de l’obligation, pour une personne, de vivre dans sa communauté (foulard). À ceux-là, je réponds que je prends pour acquis le consentement d’une personne dotée de raison. Je n’ai pas d’éthique du soupçon et j’aurais sans doute la même réaction vis-à-vis du consentement d’une personne malade face à un médecin. D’un autre côté, certains estiment que, dans la mesure où la personne consent, le problème est réglé. Ils font du consentement individuel un argument de l’émancipation, ce qu’il est, mais sans s’interroger sur ce que représente ce consentement par rapport à l’ensemble politique et social dans lequel nous vivons. Or, la somme des consentements individuels fait-elle un consentement collectif ? Quel monde allons-nous créer à partir de ces consentements individuels, que l’on ne chercherait qu’à réguler ? De la même façon, chacun avance l’argument du consentement comme une réponse. Moi, je le transforme en problème. J’ouvre la boîte de Pandore et je vois que c’est un mot très compliqué. Dans le dictionnaire, il est question d’adhérer (expression de la liberté), et aussi d’accepter (expression des limites de cette liberté)…
É & C : Vous dites que la question du consentement est finalement celle du rapport à l’autre. Ce rapport est souvent dissymétrique, notamment dans la relation médecin/malade…
G. F. : Le consentement est toujours un lien, un rapport. On ne consent pas tout seul. C’est l’expression d’un individu singulier dans un rapport à l’autre, et cet autre peut être « un » ou « des » individus. Prenons le cas d’une relation à deux, comme le mariage ou le divorce. C’est là qu’intervient la distinction entre égalité et liberté. Si on est dans le consentement mutuel, c’est de l’égalité. En revanche, dans le divorce pour faute, ou le mariage imposé, on se trouve dans un rapport de dissymétrie du consentement.
La question posée par la médecine est celle qui est posée par le rapport de force. Il n’est plus question d’égalité, mais de liberté. Il s’agit de savoir quel est le degré de liberté du malade. Est-il assez important ? La loi donne-t-elle plus de liberté au patient ? Entre le médecin et le malade, c’est un rapport nécessairement dissymétrique, inégalitaire.
É & C : L’information du malade peut-elle réduire cette dissymétrie ? Est-elle la condition à remplir avant d’obtenir son consentement ?
G. F. : Il faudrait distinguer ici la question du savoir de celle du consentement. Certains malades veulent savoir, d’autres pas. C’est une question controversée, celle de l’éclairage voulu par le malade. Au fond, la question posée est celle de la liberté du malade et de son pouvoir. Si le patient a plus de liberté pour consentir à tel traitement ou à tel protocole, cela devrait accroître son pouvoir face au médecin. Autre exemple, si l’on considère que porter le foulard est un acte de liberté, on suppose que cela va favoriser la liberté de la personne, donc son pouvoir social.
Concernant la condition à remplir avant d’obtenir le consentement du malade, je dirais qu’il ne faut pas douter de sa liberté. La liberté, c’est l’exercice de la raison, c’est supposer que tout être est un être de raison. Je dis ça sous cette forme car, historiquement parlant, la façon de maintenir l’inégalité entre les sexes, autour de la Révolution française, a été de douter de la raison des femmes. Or, le postulat de l’émancipation, c’est que l’on a tous la même raison. C’est l’argument auquel je me réfère, également dans le domaine médical.
Par rapport à l’information du malade, le médecin n’a pas seulement un savoir à proposer, il a aussi l’expérience, avec laquelle il composera bien mieux que le malade. Pour le médecin, la notion de consentement l’oblige à rendre des comptes. Si le savoir lui donne le pouvoir, il en perd en partageant ce qu’il sait avec le patient.
É & C : Qu’en est-il du consentement libre et éclairé, auquel on a recours notamment en médecine ?
G. F. : Aux adjectifs « libre » et « éclairé », je rajoute l’adjectif « tacite ». Ce mot pose la question du moyen par lequel on dit « oui ». Cela rappelle tous les débats sur le viol. Dit-on « oui » quand on le prononce verbalement ? En effet, il arrive que soient supposés des consentements alors qu’ils ne sont pas énoncés. C’est la question de savoir quel est le langage, est-il verbal ou corporel ? « Tacite » renvoie aussi à l’expression « Qui ne dit mot consent ». Par ailleurs, on peut à la fois consentir et résister ; et consentir, est-ce pareil qu’obéir ? S’agissant du consentement « libre », je considère que cela concerne l’individu et non le groupe. L’adjectif « éclairé » renvoie quant à lui à la question du savoir. Mais, au fond, qu’est-ce que l’éclairage ? Si cela sous-entend que la médecine est une science exacte, c’est lui accorder trop de crédit. Le médecin ne sait pas toujours quels seront les résultats d’un traitement. Les patients atteints de cancer sont souvent dans l’obscurité, et non dans l’éclairage.
É & C : Existe-t-il des limites au consentement ?
G. F. : Il y a des frontières, mais comment les tracer ? Il est impossible de le savoir. Le débat sur le consentement est limité par les richesses incroyables de ce mot, dont j’ignore jusqu’où elles peuvent nous mener. Il s’agit pourtant d’une question importante pour la médecine. Ce qui est certain, c’est que, dans la question politique du contrat social telle que j’ai envie de la poser, et telle que la médecine veut la poser « Quelle société est la meilleure possible ? » le consentement ne va pas pouvoir dicter sa loi partout. Il ne peut pas exister seul. Par ailleurs, dans certaines situations, comme dans le cas du foulard, la société peut prendre en charge la responsabilité de la décision, à travers une loi, au lieu de la faire peser sur l’individu. Ensuite, la possibilité de braver la loi existe aussi. Le consentement pose aussi la question de la révolte.