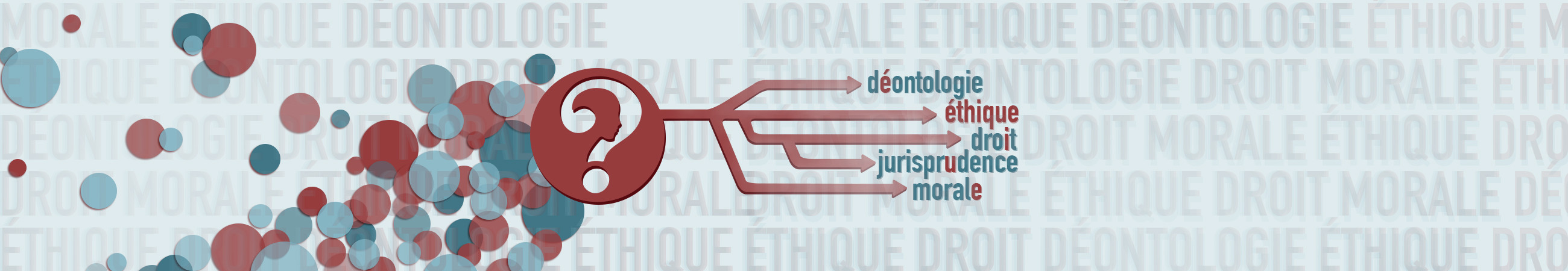La démarche palliative : une culture différente
Auteur de la loi sur le droit des malades et la fin de vie d’avril 2005 et président de la mission d’évaluation de cette même loi, Jean Leonetti a accepté de clarifier des dispositions encore peu connues, sinon peu pratiquées par le corps médical. Il revient sur les notions de qualité de vie, de soulagement et d’euthanasie, cette dernière n’étant pas autorisée en France.
Éthique & Cancer : Sur quels éléments s’est basée la mission d’évaluation de la loi sur le droit des malades et la fin de vie pour estimer que cette loi demeure trop peu connue et insuffisamment appliquée ?
Jean Leonetti : Nous avons réalisé la mission d’évaluation sur la loi de 2005 après l’affaire Chantal Sébire. Mais déjà, depuis l’évaluation de la démarche palliative dans les hôpitaux par Régis Aubry, nous savions que beaucoup de membres du corps médical pensaient connaître la loi, alors que ce n’était pas le cas. De mon côté, parmi la centaine de conférences que j’ai données en France, je me rendais bien compte que de nombreux médecins pensaient avoir pratiqué l’euthanasie alors qu’ils étaient complètement en conformité avec la loi. Il y avait donc cette ambiguïté. Des études différentes ont aussi montré que la loi n’était pas appliquée, en termes d’accompagnement et de soulagement de la douleur en fin de vie. C’est d’autant plus surprenant que la loi n’est pas en contradiction avec les règles de déontologie médicale, comme le fait de limiter la souffrance ou qu’il n’y ait pas d’abandon. En fait, je crois qu’elle bouscule d’anciennes habitudes. C’est une culture différente.
É & C : Vous avez évoqué les principes de non-abandon et de non-souffrance. Qu’entend-on par là ?
J. L. : Après l’affaire Chantal Sébire, notre réflexion est partie de ces hommes et de ces femmes qui demandent la mort. Nous nous sommes demandés pourquoi ils en arrivaient là. La première cause de cette demande de mort est la douleur. La deuxième est la solitude et le sentiment d’abandon. La troisième est l’absence de sens à la vie menée. Il y a là une dimension philosophique. Sur les deux premières causes, la médecine et la solidarité peuvent agir. Ces deux grandes règles de la loi, non-abandon et non-souffrance, veulent dire qu’on ne lâche pas le malade quand on est en échec. Les Anglais ont deux mots : care et cure. Chez nous, l’expression « prendre soin » montre bien une dimension globale du soin, qui donne au malade un intérêt au-delà de la possibilité de le guérir. Quand la mort est proche, le but n’est plus d’aboutir à la guérison mais à une qualité de vie, à un mieux-être.
É & C : Pour le médecin, la mort est donc un échec médical ?
J. L. : Oui, il a une déception et, en même temps, c’est une remise en cause de sa pratique et de sa personne. L’approche de la mort est triste pour son malade, dévalorisante pour lui et angoissante dans l’image de mort qu’elle lui renvoie en tant qu’individu. Donc, tout concoure à ce que le médecin fuie. Il va le faire de trois façons : par l’acharnement thérapeutique, en fuyant physiquement ou en accélérant la mort. Paradoxalement, acharnement et euthanasie relèvent de la même fuite. C’est plus difficile d’accepter la mort, de soulager et d’accompagner. La culture palliative pénètre dans nos pratiques et dans nos mœurs médicales, mais on ne peut pas nier qu’il y a les médecins qui font du palliatif et ceux qui font de la chirurgie. C’est rare qu’il y ait un dialogue entre les deux. Or, la culture palliative n’est pas d’appeler le médecin de soins palliatifs quand on sait qu’on ne peut plus sauver le patient, c’est la prise en charge du début à la fin.
É & C : Qu’est-ce que l’obstination déraisonnable en cancérologie ?
J. L. : C’est se rendre compte que ce qu’on fait est vain et s’obstiner au-delà de la raison. Si je fais une caricature, l’obstination déraisonnable est la chimiothérapie qui est mise en place à quelques jours de la mort. Ce sont les chirurgies mutilantes pour des bénéfices de survie minimes. Or, tout ce qui est possible n’est pas souhaitable. Le soin en cancérologie, plus encore que dans les autres disciplines, doit être une décision proportionnée. L’acharnement thérapeutique est difficile à évaluer. D’abord, c’est un mauvais terme, car, en médecine, l’acharnement n’est pas négatif. Nous l’avons donc remplacé dans la loi par l’obstination déraisonnable. Mais, pour arriver à la définir, il faut être plusieurs. À un moment donné, c’est la collégialité qui tempère. Le doute, ce n’est pas faire ou ne pas faire. C’est un doute fertile : on pèse et on décide. C’est une attitude équilibrée au cas par cas.
É & C : Comment appréhender le refus de soins énoncé par le patient ?
J. L. : Il doit être respecté. Il faut le disputer, quelquefois âprement, mais le respecter. Pour illustrer ce propos, voici deux cas qui m’ont frappé dans ma carrière de médecin. Il y a celui de cette jeune femme qui souffrait d’un cancer du sein que l’on pouvait soigner, mais que je n’ai jamais réussi à convaincre de se faire opérer. Elle était dans une situation psychologiquement difficile dans son couple et pensait que son compagnon l’abandonnerait si elle se faisait retirer le sein. Elle savait ce qu’elle risquait et elle a quitté l’hôpital. J’avais été frappé de voir que l’on pouvait avoir les arguments médicaux les plus rationnels, mais quand le malade dit non, il dit non. L’autre exemple me vient d’un vieux monsieur qui souffrait d’une gangrène et que l’on devait amputer pour prolonger sa vie de quelques mois. Il n’a jamais voulu. Entre ces deux cas, il y a une différence dans le temps de vie qu’une opération aurait fait gagner à chacun des patients. Mais la différence la plus importante, c’est que la jeune femme était en ambulatoire et que le vieux monsieur était dans un lit d’hôpital. L’une pouvait m’échapper, l’autre non. La vraie question éthique est ici : est-ce que, parce qu’il ne peut pas m’échapper, j’ai le droit d’imposer à un patient quelque chose qu’il refuse ? C’est un vrai problème, car souvent on est plus “agressif” d’un point de vue thérapeutique avec les malades internés.
É & C : Qu’est-ce qui distingue l’acte sédatif de l’euthanasie ?
J. L. : Il y a d’abord une différence entre la personne à laquelle il reste beaucoup de temps à vivre et celle à laquelle il en reste moins. Je précise cela parce que le paradoxe veut que, dans la phase terminale, s’il y a une prise en charge de la souffrance et de la solitude, il n’y a pas de demande de mort. Si, en fin de vie, il reste quelques heures à vivre à une personne malade qui souffre ou qui a de l’angoisse, j’ai le droit de traiter sa douleur dans une proportionnalité qui fait que même s’il y a un double effet, c’est-à-dire une intention bonne et un effet secondaire mauvais, cela ne m’est pas reproché sur le plan déontologique. La différence avec l’acte d’euthanasie est dans l’intentionnalité, qui se vérifie par la collégialité et l’écrit. Pour résumer, si je veux soulager la vie d’un patient, j’ai tous les droits. Si je veux la raccourcir, je n’en ai aucun. Et si le prix à payer pour le soulager est de raccourcir sa vie, dans mon imaginaire, j’ai quand même le droit de le faire. On a levé l’interdit de soulager devant le risque d’accélérer la mort.
É & C : N’est-ce pas une façon de ne pas parler d’euthanasie et de mort dans une loi ?
J. L. : Je ne sais pas écrire la mort dans une loi. Quelle est la justification de la demande de mort ? Est-ce la phase terminale ? Tous les cas apparus dans la presse n’en étaient pas à ce stade. Sont-ce les maladies très graves ? Quelles sont-elles ? Au fil de la réflexion, le processus glisse de l’euthanasie vers le suicide assisté, qui pose d’autres problèmes philosophiques. Et vous finissez par estimer qu’il faut respecter la demande puisqu’elle est le fait d’une personne autonome. Le paradoxe est alors que l’on ne va plus donner la mort aux personnes en phase terminale, puisqu’ils ne la demandent pas, mais à celles qui sont loin de la mort. Le vrai débat éthique est entre l’autonomie de la personne et sa vulnérabilité.
É & C : Qu’a apporté le débat citoyen initié lors des états généraux de la bioéthique ?
J. L. : En participant aux forums, les Français ont montré qu’ils s’intéressaient aux questions éthiques et que le sujet n’est pas trop compliqué, contrairement à ce que l’on nous annonçait. Il n’y a pas d’expert en éthique. Les réflexions des citoyens viendront s’ajouter aux avis compétents du Conseil d’État, du comité consultatif d’éthique, de l’Agence de la biomédecine… C’est irréversible : on ne pourra plus décider dans un dialogue clos entre experts et politiques. Des débats citoyens, il ressort une idée générale qui va porter la loi : la bioéthique est au service de la médecine et la médecine est au service de quelqu’un qui est en souffrance. Elle ne répond pas à un désir ou à une insatisfaction sociétale, si légitime soit elle.