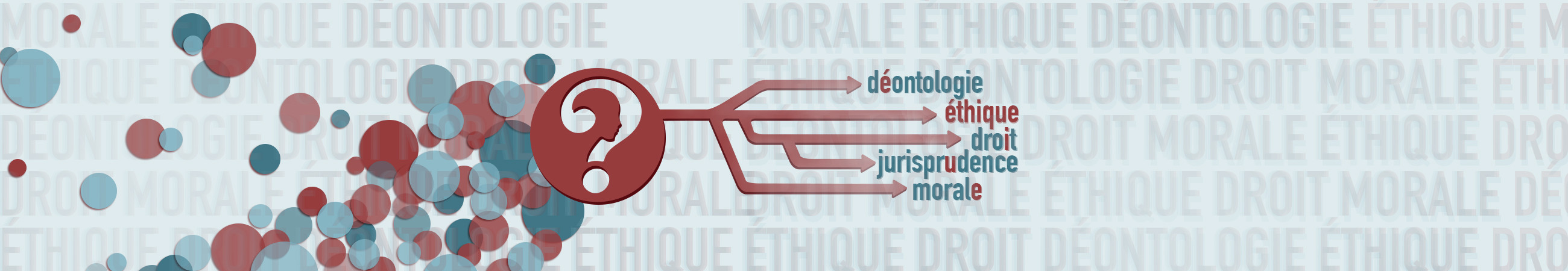Dire l’éthique ?
Nous sommes les héritiers d’un monde dans lequel la morale révélée tenait une place centrale. Il y était relativement simple de voir, de comprendre, si ce n’était d’admettre, qui était en responsabilité de dire cette morale et d’en préciser les termes. L’éthique, dont certains disent qu’elle est « une morale en marche » ne possède pas ce caractère révélé. Il s’agit donc d’une démarche en élaboration permanente. Pourtant, nombreux (et divers) sont ceux qui prétendent « dire » l’éthique et font pression sur la société pour qu’elle s’oriente dans tel sens ou tel autre, pour qu’elle accepte ceci ou bannisse cela. On cherche parfois à remplacer un code moral par des impératifs éthiques, à ériger en principes certaines valeurs qui, pourtant, ne sont pas toujours partagées dans une société pluraliste. Ne cherche-t-on pas simplement à substituer le mot « éthique » à celui prétendument plus désuet de morale ?
Nous ne sommes pas toujours, de fait pas souvent, d’accord sur ce qu’il est juste de faire. Dans un État de droit, ce sont la loi et la justice qui disent ce qui est permis ou défendu, qui gèrent le « vivre ensemble ». Pour cela, il ne leur est nécessaire de définir ni la valeur des actes ni les notions de bien et de mal. « Droit, éthique, politique revendiquent chacun, dans la mission qui leur est confiée, la responsabilité de dire le juste et le bien commun », écrivait Didier Sicard en préface d’un ouvrage sur les grands avis du Comité consultatif national d’éthique1. Et il faisait remarquer que c’est du dialogue entre les trois que peut naître une vraie richesse, ainsi qu’un dynamisme. Il s’agit d’une dynamique nécessaire dans les domaines en forte évolution des sciences du vivant et de la santé. Il s’agit d’une évolution sociétale, mais surtout d’une évolution technologique toujours plus rapide. Ces évolutions s’inscrivent dans les temps de la politique, du droit et de l’éthique, qui ne sont pas les mêmes.
Aujourd’hui, la santé est devenue une préoccupation sociale majeure ; les scientifiques et les soignants, avec leurs savoirs techniques sont souvent ceux que la société interroge sur ce qui est bon pour elle. Elle leur demande des pistes pour élaborer son futur. Cette évolution, irrésistible en apparence, conduit la science et la médecine contemporaines à se soumettre, et à proposer de nous soumettre, plutôt au développement de normes rigides qu’à celui d’une réflexion éthique libre et indépendante. N’existe-t-il pas une certaine dictature des « sachants », qui en ferait une référence de ce qui peut, et doit être fait ? Est-ce à eux qu’il revient de décider en dernier lieu de ce qu’il est juste de faire ? Peuvent-ils être garants de ce qui est éthique ? « La vérité est que ce n’est pas à la science de régler notre vie, mais à la sagesse » leur répond Jacques Maritain2.
Principes éthiques ou préceptes moraux ?
Monique Canto-Sperber a écrit : « Être éthique ou ne pas être, c’est l’injonction contemporaine. Achetez éthique, parlez éthique, placez éthique, gouvernez éthique. Quant à ce que veut dire au juste éthique dans tous ces emplois, nul ne juge utile de le préciser. On se retranche derrière un silence prudent et lourd de sous-entendus. Tout le monde est censé savoir ce qu’est l’éthique. »3 Alors qu’insensiblement le qualificatif « éthique » est devenu un critère de qualité et que, presque en conséquence, il est galvaudé et donc se dénature, il est nécessaire de faire remarquer qu’il n’y a pas une seule éthique, une seule théorie de l’éthique, qui sans être indiscutable, serait au moins consensuelle.
L’éthique de la vertu, par exemple, met particulièrement l’accent sur les caractéristiques morales. Elle tente de répondre aux questions que nous nous posons sur la façon dont nous devrions vivre et nous conduire. Elle est l’héritière tout autant de l’éthique d’Aristote que de l’éthique chrétienne. Dans le monde occidental, l’éthique de la vertu s’est progressivement effacée devant la déontologie selon laquelle une action est bonne si elle est conforme à une règle morale, ainsi que devant l’opinion suivant laquelle l’action juste est celle qui produit le meilleur résultat, et cela peut-être sous une influence croissante de la pensée anglo-saxonne.
Parallèlement, avec la naissance de la bioéthique dans les années 1970, cette pensée dominante a institué une approche dite principielle. Quatre grands principes ont ainsi été posés comme cribles dans l’évaluation de nos actions : la prise en compte et le respect de l’autonomie de la personne, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice4. Le cadre imposé par ces « impératifs » éthiques est parfois trop étroit, et l’on est contraint d’imaginer d’autres « principes » tels que la pertinence, en matière de recherche par exemple, ou la solidarité. Celle-ci résulte d’un lien social a priori, alors que l’autonomie est parfois convoquée pour justifier une démarche individuelle plus proche, elle, de la générosité que de la solidarité.
Le poids que l’on attribue à chacun de ces principes, ainsi que la cohérence qu’ils peuvent entretenir les uns avec les autres reposent sur des convictions personnelles autant que sur des pressions sociales, voire s’inscrivent dans un « air du temps » né dans les représentations de ce qui est moralement bon ou au contraire moralement inacceptable à un moment donné. La question demeure de savoir si ce sont ces principes de l’éthique biomédicale qui créent de novo un cadre normatif éthique, ou si, en fait, ils ne témoignent pas de normes morales a priori, d’une soi-disant morale commune qui se cache derrière une prétention d’universalité.
L’éthique, une affaire d’experts ?
L’application de principes éthiques (éthique appliquée) suscite un intérêt croissant et justifie une demande forte de « gouvernance éthique » dans nos sociétés. Cette demande est particulièrement importante dans les domaines liés aux sciences du vivant et de la santé. C’est d’ailleurs dans ces domaines que l’on rencontre pléthore d’experts en éthique autoproclamés. La sociologie et l’anthropologie ont révélé la dimension de construction sociale de l’expertise, son rôle politique, et souvent hélas sa fonction d’alibi pour les intérêts particuliers de certains sous-groupes. On peut ainsi légitimement s’interroger sur ce qu’est un « expert éthicien ».
Ces « éthiciens » ont pour fonction d’éclairer et d’accompagner les questionnements et les débats éthiques ; pourtant, on en attend souvent des réponses toutes faites, quitte à les voir devenir des « donneurs de leçons »5. Peut-on s’en étonner alors qu’une des fonctions de l’analyse des enjeux éthiques est la production de recommandations destinées aux décideurs. Or, l’expérience montre que ces décideurs sont particulièrement avides de codes de bonnes pratiques, voire d’un « prêt à penser » éthique.
Au contraire, souhaitant que les questionnements éthiques, qui nécessitent une analyse interdisciplinaire ne se cantonnent pas à des débats d’experts, Raymond Massé s’interrogeait : « Quelle peut alors être la place des savoirs populaires, et plus précisément des « moralités séculières », dans les délibérations éthiques ? Comment intégrer une véritable préoccupation pour des « considérations sociales » en éthique publique ? Comment faire place à la participation du public sans se placer à la remorque d’une éthique empiriste tributaire d’une gestion par « sondage d’opinion morale » et marquée au sceau de la « tyrannie de la majorité », d’une « dictature des mal informés » ? ». Il ajoute : « Le débat sur la participation du public aux enjeux éthiques n’a que peu de sens aux yeux de ceux qui considèrent que l’éthique doit demeurer entre les mains des experts, seuls habilités à inscrire leur argumentaire dans des théories éthiques complexes »6.
Et complexes, les enjeux de santé le sont, à commencer par la définition même de la santé. Au lendemain d’une guerre dont le cortège d’atrocités avait contribué à montrer que la santé était plus qu’une simple absence de maladie, les experts de l’Organisation mondiale de la santé avaient donné, en 1946, une définition de la santé, dont beaucoup aujourd’hui s’accordent à dire qu’elle n’est pas satisfaisante, mais que nous conservons, faute de mieux. Cette définition relève en effet davantage de la définition du bonheur puisqu’elle renvoie à un épanouissement total d’un point de vue physique, mental, psychique et social. Elle doit être aujourd’hui remise en cause parce que la durée de vie augmente et qu’il convient aujourd’hui d’y intégrer les maladies chroniques, ou qui se chronicisent, comme les cancers dont nous parvenons désormais à guérir certains ou au moins à les stabiliser. Avoir transformé une maladie mortelle en une maladie chronique ouvre un immense champ de questionnements éthiques, duquel une définition de la santé réaliste et opérationnelle n’est peut-être que la partie la plus visible, mais où les expertises profanes et le vécu tant des patients que de leur entourage apportent la dimension humaine nécessaire, particulièrement alors que nous sommes tous concernés puisqu’en grande majorité touchés.
Débat public, débat éthique
Étant donné que nous sommes tous concernés, l’éthique, la bioéthique devrait être débat, confrontation d’opinions et de convictions. Guy Bourgeault disait que « le lieu de l’éthique est celui de la discussion et du débat, avec la diversité des convictions et des options qui s’y croisent et qui se confrontent, entrant en conflit, et non, d’emblée, dans le consensus même provisoire, qui peut en résulter, »7, suggérant que l’important dans l’éthique, c’est le questionnement, l’interrogation.
L’éthique est cheminement, remise en cause, réflexion ouverte sur le monde dans lequel nous souhaitons vivre et que nous voulons laisser à nos enfants. Nul doute qu’il soit, dans ce contexte, plus « utile » d’ouvrir le champ des possibles par le questionnement que de le fermer par des réponses, malgré le confort intellectuel que celles-ci peuvent prétendre procurer. Les questionnements sur le vivant, l’être humain en particulier, sont par essence multiples et multiformes, souvent très spécialisés (scientifiques et techniques), mais ils nous concernent tous. La société ne saurait donc en faire l’économie, et doit accepter, dans ces domaines, de croiser le scientifique, le social, le technique, l’éthique et le culturel, et ainsi d’animer un débat vrai par rapport à ces questions.
Nos sociétés démocratiques sont férues de débats publics, elles ont créé des lieux pour cela, depuis les assemblées jusqu’à la commission nationale du débat public. Lieux de confrontation d’opinions, ils apparaissent peu propices à des débats éthiques de qualité, qui nécessitent, eux, la confrontation des idées « pour que […] de la révision de nos certitudes naisse une forme de pensée toujours en mouvement, qui vise à affirmer la dignité de l’homme dans tous les instants de son existence. »8
Des comités, comme le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), les espaces de réflexion éthique régionaux ou le Comité éthique et cancer sont des lieux plus ou moins ouverts aux citoyens, mais où la réflexion en commun permet de dépasser les nécessaires et légitimes confrontations pour qu’elle s’élabore sans s’imposer, et puisse ainsi toucher toutes celles et ceux à qui elle est destinée. Il en va du rôle social de ces comités et donc de leur utilité dans l’alimentation du nécessaire débat public que nécessitent les questionnements qu’ils portent.
La réflexion éthique n’a-t-elle pas pour fonction d’interpeler les modes de pensée et d’agir, de remettre en question les certitudes, les pouvoirs, les pensées dominantes et les modes. Face à cela, « dire l’éthique » ne serait-il pas seulement un moyen d’éviter que certaines questions se posent, soient posées ?