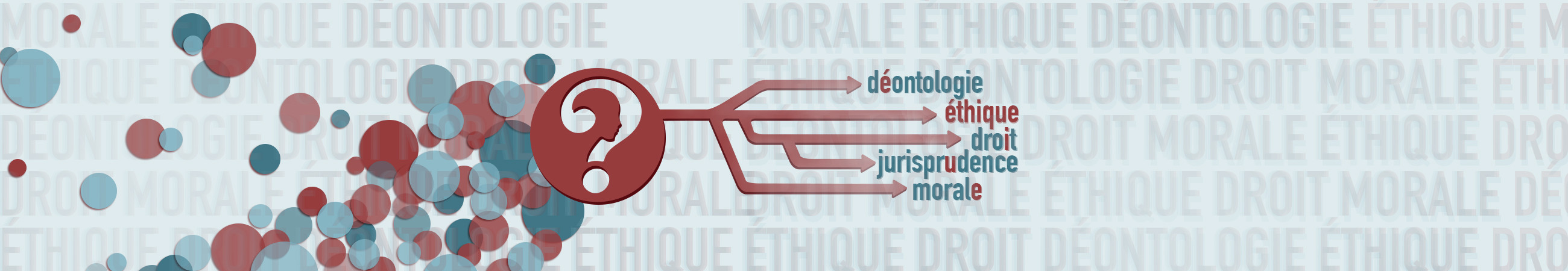Essais cliniques : Une part de risque, une grande part de connaissance
À la fois diabolisée et synonyme d’espoir, la recherche clinique en France cherche à se développer et à restaurer son image. Mais selon quelle éthique se pratiquent les essais cliniques ? Réponses de Vincent Diebolt, directeur du Centre national de gestion des essais de produits de santé (CeNGEPS), qui se montre soucieux de réconcilier les Français avec la recherche clinique, mais aussi de renforcer les performances de ce secteur.
Éthique & cancer : Les essais cliniques ont longtemps été et sont encore diabolisés, les malades ayant peur que cela se passe à leur insu : fantasme ou réalité ?
Vincent Diebolt : Dans l’Antiquité, Pline l’ancien disait déjà que les médecins s’instruisent à nos risques et à nos dépens. Il est vrai que la médecine a toujours fait d’une certaine façon un peu peur, car elle touche à notre propre existence. L’expérimentation médicale repose sur une histoire obscure et sur toute une série d’expériences qui ont été menées de manière plus ou moins éthique. Mais aujourd’hui, nous avons davantage de recul. L’expérimentation médicale s’exerce dans les conditions les plus respectueuses de la conscience humaine. La loi Huriet-Serusclat, qui date de 1988, ne s’intitule pas « projet de loi pour la recherche médicale » mais « loi pour la protection de la personne humaine ». C’est révélateur d’une prise de conscience. Il n’en reste pas moins que toute expérimentation médicale comporte un risque, qu’on essaiera de minimiser.
É & C : Quels sont les problèmes éthiques que peut poser la pratique des essais aujourd’hui ? Avant l’inclusion, durant le protocole thérapeutique et à sa sortie ?
V. D. : L’essai doit avant tout être bien conçu, c’est la première étape. D’abord, il y a une hypothèse qui doit être bien fondée, sur des connaissances scientifiques, avec une prise de conscience et une évaluation du risque potentiel. En bref, l’essai doit en valoir la peine. Ensuite, on doit, dans la rédaction même du protocole, envisager la part de risque. La seconde étape, qui est très délicate, est celle de l’accord éclairé qui doit impérativement être obtenu de la part d’un patient. C’est tout le problème de la rédaction des documents d’information. Un patient, pour accepter un essai, doit le faire en toute connaissance de cause. Mais le document doit-il être complet – donc peut-être illisible et indigeste –, ou court et succinct – donc incomplet ? C’est une question quasi insoluble, d’où la nécessité de faire jouer un rôle aux associations de patients.
Enfin, quand le patient a participé à l’essai clinique, se pose la question de l’obtention des résultats. La loi prévoit qu’une information soit apportée au patient sur les résultats de l’essai, et il est normal qu’il veuille savoir à quoi a servi sa participation et ce que cela a donné. Mais l’on se retrouve confronté à deux problèmes : le temps d’obtention des résultats, qui ne sont disponibles qu’un an, voire deux ou trois ans après la fermeture des inclusions, et la présentation et l’interprétation de ces résultats, quelquefois fort complexe.
É & C : Georges Canguilhem, philosophe et médecin français, disait encore il y a quelques années : « On ne soigne, c’est-à-dire on n’expérimente, qu’en tremblant » : est-ce toujours vrai aujourd’hui ?
V. D. : Canguilhem se positionnait en fait par rapport à tout le mouvement issu de la médecine expérimentale de Claude Bernard au xixe siècle, qui légitimait les conditions de réalisation de l’expérimentation médicale avec une part de risque. Depuis, des progrès diagnostiques et thérapeutiques ont été réalisés et sont à prendre en compte. Aujourd’hui, on fonctionne sur un système de protocole de soins qui sont balisés. Donc « on ne soigne qu’en tremblant » : non ! Le plus souvent, on soigne avec une part de risque – le métabolisme humain est d’une immense variabilité et chaque cas reste unique –, mais on soigne quand même avec une grande part de connaissance. Je serai donc amené à moduler l’assertion de Canguilhem, mais en disant qu’elle garde toujours une part d’actualité.
É & C : Que dire des essais par tirage au sort et de l’utilisation du placebo ? Est-ce éthique ?
V. D. : On entend par placebo un produit inactif qui servira de témoin au produit à tester. Il permet d’objectiver le bénéfice de ce dernier. Aujourd’hui, sur des personnes non malades – et justement ce sont les conditions d’éthique préalables –, un certain nombre de contraintes ont été imposées, qui sont là pour protéger la population. Autre point qui me semble très important : pour des personnes malades, la règle appliquée est qu’on ne les laisse pas sans soin. Sur elles, on va tester un produit à titre expérimental. Le placebo n’est pas utilisé, sauf dans certaines conditions, mais à des cas extrêmement dérogatoires. Dans ce cas, le malade doit être au courant que cela pourrait être un placebo. C’est très important. Mais en aucun cas, on mettra des patients sous placebo si cela doit être préjudiciable à leur santé.
É & C : Le consentement du patient est-il réellement éclairé, notamment en phase 1 de l’essai1, où le médecin n’a pas lui-même toute l’information pour présenter une molécule ?
V. D. : Lorsqu’un produit va être expérimenté sur l’être humain, il a déjà subi des tests : une phase de tests in vitro puis une phase de tests précliniques sur le modèle animal. Ce qui veut dire qu’on a déjà une première connaissance de l’intérêt potentiel de la molécule. Nous ne sommes plus au temps où l’on imaginait une molécule et où elle était testée sans la moindre idée de ce que cela pourrait donner. Il y a un certain nombre d’impératifs qui font que le praticien, lorsqu’il va parler pour la première fois à un patient d’un produit, va pouvoir dire ce que l’on sait de la molécule et quels effets peut-elle potentiellement avoir. C’est tout l’intérêt d’avoir cette information et de la donner : la part d’ombre et la part de lumière, pour que la personne puisse décider en toute connaissance de cause.
É & C : Les essais de phase 1 sont en général proposés à des patients en fin de ressource thérapeutique. Dans ces conditions, peuvent-ils vraiment refuser d’y participer, alors que l’essai est pour eux synonyme d’espoir ?
V. D. : C’est terrible de dire cela, mais, à ce stade, la personne n’a plus vraiment ni le temps ni le choix de refuser. Elle peut tout de même le faire, car elle est libre de décider de sa mort. De ce point de vue-là, elle décide librement. Il faut savoir aussi que participer à un essai pour un patient en phase terminale peut signifier un risque supplémentaire mais aussi de nouvelles douleurs éventuelles. Il y a là une marge de choix supplémentaire, même minime : au-delà de l’espoir qu’on peut avoir, quelle contrainte et quelle douleur cela peut-il représenter ? En termes éthiques, je réponds donc en disant que la marge de choix à ce stade ne doit plus être conçue en termes de risque mais aussi en termes de chance, et qu’il faut ajouter un élément dans le dialogue entre le patient et son praticien concernant la contrainte et la douleur. Il ne s’agit plus seulement pour le patient de savoir quelle chance il a de vivre et pour combien de temps, mais aussi de voir quelle est la part de souffrance et quelles précautions seront prises pour l’en prémunir.
É & C : En cancérologie, le patient est particulièrement vulnérable psychologiquement. A-t-il, selon vous, toutes les capacités cognitives pour signer librement un consentement ?
V. D. : Les Plans cancer ont beaucoup insisté sur l’accompagnement psychologique. Une personne malade est plus faible psychologiquement et plus déstabilisée qu’une personne non malade. On s’aperçoit tout de suite qu’il y a une fragilité. Il faut savoir aussi que les fiches d’information qui sont signées et qui permettent à la personne de donner son consentement sont vues et validées par le Comité de protection des personnes. Cela me semble important et donne un cadre concret au recueil du consentement. À la question de savoir si toute personne, compte tenu de son état, est apte ou non à signer un consentement : si l’on considère qu’elle ne l’est pas, comment faudrait-il alors concevoir la procédure ? Faudrait-il qu’il y ait la présence systématique d’un proche, d’un patient, ou d’un représentant d’association ? Je pense qu’il faut laisser la personne conserver son libre arbitre, qu’elle soit malade ou saine.