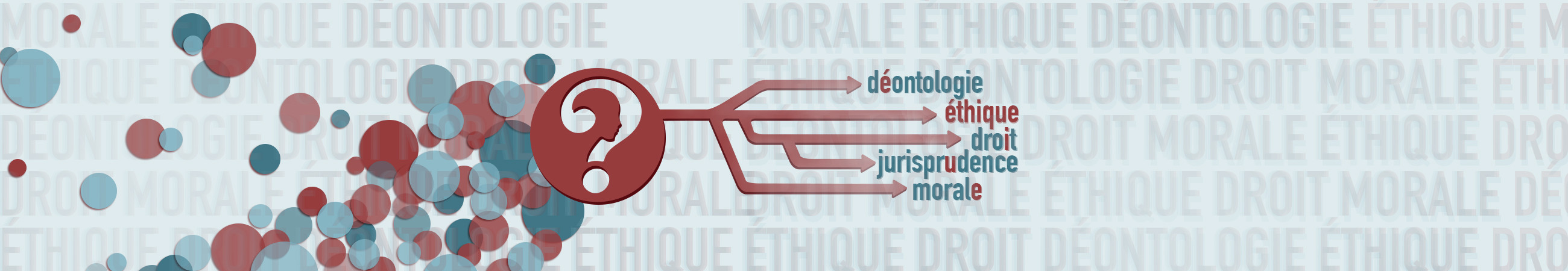Faut-il dépister le cancer de la prostate ?
« Alors que 10 % des hommes sans cancer de la prostate ont un PSA positif, un homme sur six ayant un PSA négatif a, en réalité, un cancer. », Gérard Dubois, professeur de santé publique au CHU d’Amiens
Le dépistage du cancer de la prostate se banalise depuis quinze ans, alors même que cette pratique n’a pas démontré son utilité. À l’âge de 60 ans, au moins un homme sur trois a un cancer dans sa prostate. Entre 0 et 74 ans, 1,3 % des hommes en meurent. La majorité des cancers ne s’expriment pas cliniquement, encore moins tueront. Aucun critère ne permet de séparer les cancers dits indolents de ceux qui vont évoluer. S’agissant du diagnostic par PSA (Prostate Specific Antigen), qui s’effectue par une simple prise de sang, les chiffres sont éloquents. Alors que 10 % des hommes sans cancer de la prostate ont un PSA positif (supérieur à 4 nanogrammes par millilitre), un homme sur six ayant un PSA négatif a, en réalité, un cancer dans sa prostate. Le PSA est donc un test très médiocre.
Efficacité remise en cause
Il faut ajouter que sur deux cancers dépistés vers 60 ans, le premier ne s’exprimera jamais alors que les complications liées aux traitements sont loin d’être anodines (incontinence et d’impuissance), tandis que pour le second, le dépistage n’a pas fait scientifiquement ses preuves. De son côté, l’AFU (Association française d’urologie), pour justifier le dépistage, indique que la proportion de cancers métastasés dès le diagnostic a été divisée par quatre. C’est une illusion d’optique car c’est le nombre de cancers diagnostiqués qui a quadruplé aussi à cause du dépistage, le nombre de cancers métastasés restant inchangé. Les campagnes de l’AFU ont eu pour conséquence qu’en 2003, plus de 2,6 millions de tests PSA ont été réalisés soit un dépistage massif qui n’est pas évalué. Aujourd’hui, la majorité des recommandations internationales n’est pas favorable au dépistage du cancer de la prostate et de nombreux articles internationaux récents le mettent en doute. De leur côté, l’HAS (Haute autorité de santé) et l’INCa (Institut national du cancer) ont rappelé qu’ils ne recommandaient pas ce dépistage. Enfin, l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé vient de se saisir du sujet. Le temps des décisions basées sur les preuves est enfin venu. Toute autre approche ne serait pas éthique.
« Le PSA représente une révolution dans le diagnostic de ce cancer. », Philippe Mangin, chef du service d’urologie du CHU de Nancy et ancien président de l’Association française d’urologie
Le cancer de la prostate évolue en trois phases. Il est d’abord localisé à la prostate, mais non détectable avec les outils disponibles. Bien qu’encore localisé à la glande prostatique, il est ensuite détectable par le toucher rectal et/ou le PSA (Prostate Spécific Antigen). C’est cette deuxième phase dite fenêtre de curabilité qu’il ne faut surtout pas laisser passer, car elle est relativement brève, de l’ordre de 1 à 3 ans. Enfin, le cancer est facilement détectable mais devenu incurable. Ce n’est qu’à la fin de cette troisième phase que ce cancer donne des symptômes. N’en donnant jamais quand il est localisé, il n’existe aucune autre stratégie que le dépistage pour le découvrir à ce stade. La méconnaissance très répandue de cette notion de base explique les fausses informations véhiculées de toutes parts, dont hélas près de 10 000 hommes font les frais chaque année en France.
3 raisons et 2 objectifs
La question du dépistage se pose réellement pour trois raisons : la première, c’est l’espérance de vie qui ne cesse d’augmenter. Elle est aujourd’hui de plus de 75 ans avec environ 60 000 nouveaux cas de cancer de la prostate par an ; la seconde, c’est l’apparition du PSA, marqueur spécifique de la prostate. Son utilisation représente une véritable révolution dans le diagnostic de ce cancer. Ne pas l’utiliser pour dépister le cancer le plus fréquent de l’homme n’est pas acceptable ; la dernière, c’est l’existence de traitements localisés de plus en plus efficaces et de moins en moins délétères. Les objectifs du dépistage sont doubles : d’une part, ne pas arriver trop tard. Il faut absolument débusquer le cancer de la prostate quand il traverse la fenêtre de curabilité ; d’autre part, ne pas surtraîter. La fréquence des cancers microscopiques chez l’homme âgé et la vitesse d’évolution souvent lente de ce cancer imposent de ne pas dépister n’importe qui et jusqu’à n’importe quel âge. Il est d’ailleurs possible dans certains cas, d’adopter une attitude de surveillance active. En attendant de nouveaux outils de diagnostics, les modalités raisonnables du dépistage sont les suivantes : entre 50 et 75 ans, par un dosage annuel du PSA total et si possible un toucher rectal, et dès 45 ans dans les populations ou les familles à risque. À l’avenir, il est très probable que les modalités de dépistage soient définies en fonction de risques statistiques pour telle population, telle famille, voire telle personne et par conséquent ne soient pas standardisées. Le dépistage du cancer de la prostate doit donc faire partie maintenant de la bonne pratique médicale. Tout homme ayant dépassé 45 ans doit en avoir connaissance, pour mettre fin en France à une regrettable et injuste dichotomie entre « ceux qui ont le tuyau et ceux qui ne l’ont pas ».
« Dépister n’est pas un dogme religieux », Paul Benkimoun, journaliste au Monde
Pour un journaliste écrivant à destination du grand public, la controverse sur le bien-fondé ou non d’un dépistage systématique du cancer de la prostate n’est pas un sujet nouveau. Le débat existe depuis plusieurs années entre la société savante des urologues et les autorités sanitaires (Anaes, puis HAS). Il fait écho à une question classique, séparant souvent épidémiologistes et cliniciens. Partant d’une approche populationnelle, les premiers soupèsent les bénéfices et les risques. Les seconds mettent en avant l’incidence de la maladie et le nombre de cas pouvant être évités, faisant vibrer une fibre individuelle. Avec un sujet comme l’accroissement du risque cancéreux lié au traitement hormonal substitutif de la ménopause, nous avons vu à quel point les tensions pouvaient être fortes, et vifs les reproches adressés aux journalistes, soupçonnés d’avoir pris fait et cause pour l’une ou l’autre des thèses. En aurait-il la compétence, le journaliste ne saurait se substituer au médecin praticien et répondre au patient lecteur : « Vous devez (ou vous ne devez pas) pratiquer cet examen systématique.» Il lui appartient en revanche de fournir à celui qui le lit les éléments, parfois contradictoires, pour s’orienter dans sa réflexion, afin de trancher par lui-même, en concertation avec son médecin. Mais, parce qu’il n’échappe pas lui-même au problème d’optiques qui séparent épidémiologistes et cliniciens, le journaliste doit écrire en pensant à la fois à l’ensemble des lecteurs (forcément hétéroclite dans son niveau de connaissances et de perceptions) et à chacun d’entre eux. On peut donner des statistiques sur le taux de survie à 5 ans pour un cancer donné, mais quel en est l’impact individuel pour la personne concernée ? La question du dépistage systématique et de ses effets pervers ou indésirables mérite d’être posée sans tabou. Dépister n’est pas un dogme religieux, mais une politique de santé publique. Elle doit être justifiée scientifiquement, médicalement, humainement et financièrement. Ces aspects doivent être présents dans le traitement journalistique d’un sujet.