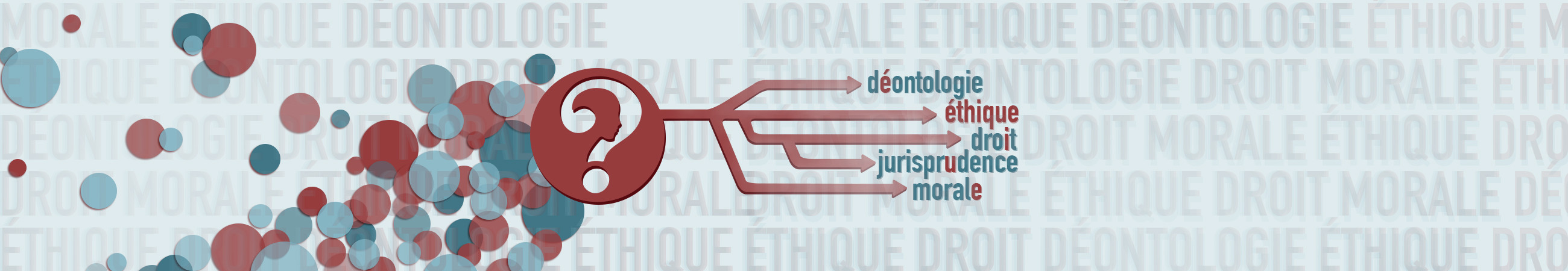L’éthique clinique, loin des concepts, au plus près de la souffrance
Faut-il poursuivre les soins chez ce bébé ? Est-il raisonnable d’accorder une ultime chimiothérapie à cette patiente ? Au centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin, les dilemmes éthiques arrivent chaque jour via un simple courriel ou un coup de fil. L’équipe pluridisciplinaire, dirigée par le Dr Véronique Fournier, a pour mission de démêler en quelques jours l’écheveau dans lequel s’entremêlent l’éthique et l’intime.
Propos recueillis par
Éthique & cancer : Pour vous, comment se définit l’éthique, plus encore qu’entend-on par “éthique clinique” ?
Véronique Fournier : J’ai souhaité donner ce nom d’“éthique clinique” à notre aventure pour la distinguer de l’éthique médicale. Pour nous, l’éthique n’est pas uniquement une affaire de médecins. Les patients et leurs proches ont aussi voix au chapitre. Eux aussi sont des agents éthiques. L’éthique est aussi clinique parce qu’il s’agit de réfléchir sur des situations concrètes et à chaud plutôt que sur de grands concepts. Les belles idées théoriques que nous pouvons avoir de loin résistent-elles à l’épreuve de la réalité du terrain ? Enfin, la dernière spécificité de l’éthique clinique, c’est qu’elle se veut être en quelque sorte “thérapeutique”. Elle n’est ni “interdisante”, ni “comminatoire”. C’est une approche qui vise à accompagner et, par ce biais, à adoucir la difficulté de l’épreuve que traversent ceux qui sont confrontés à la décision qui fait conflit : le malade, ses proches, les soignants.
É & C : Travaillez-vous uniquement de manière casuistique ?
V. F. : Oui, nous travaillons essentiellement au cas par cas. Mais, depuis quelques années, nous faisons aussi de la recherche en éthique clinique sur des séries de cas… Nous nous intéressons alors à une pratique particulière, parce qu’elle pose un problème éthique pour une équipe. Le travail consiste à voir si, pour cette pratique, les questions éthiques se répètent de façon identique d’un cas à l’autre, et lesquelles elles sont. Nous cherchons ensuite à identifier quelles pistes de travail seraient intéressantes à creuser pour avancer sur les questions éthiques spécifiques posées par la pratique qui crée problème. Comme toujours chez nous, le travail se fait de façon systématiquement multidisciplinaire. Nous avons constitué un groupe de recherche en éthique clinique, le GREC, qui publie des travaux toujours écrits à au moins quatre mains d’origines disciplinaires différentes.
É & C : La plupart du temps, vous dites agir à chaud. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Comment fonctionne le CEC ? Par qui êtes-vous sollicités ?
V. F. : C’est très simple. Il suffit de nous appeler ou de nous envoyer un e-mail. Cette sollicitation peut venir du patient lui-même, des membres de son entourage ou des soignants. Par exemple, je viens de recevoir un e-mail à propos d’un patient qui se trouve en réanimation chirurgicale. La question qui se pose, c’est jusqu’où faut-il le soigner ? Si l’on nous sollicite, c’est parce que les uns et les autres, en l’occurrence la famille d’une part, l’équipe soignante d’autre part, n’ont pas la même perception des choses. Lorsque nous sommes interrogés, nous déclenchons ce que nous appelons une “consultation”. Concrètement, un médecin et un non-médecin – il y a toujours quelqu’un de garde – vont à la rencontre des différents protagonistes. Nous les écoutons individuellement, sans jamais aucun a priori, pour essayer de bien comprendre les arguments éthiques de chacun. Ce travail peut prendre plusieurs jours. Il s’agit de recueillir les informations utiles pour répondre à toutes les interrogations qui se posent : une famille réclame-t-elle la poursuite des soins à cause de ses convictions religieuses ou pour respecter un éventuel souhait du patient ? Les infirmières sont-elles favorables à un arrêt des soins parce qu’elles ressentent la souffrance du patient ou à cause du pronostic ? Comment apprécier la qualité de vie du malade ? Tout ce matériau est ensuite débattu lors de notre staff multidisciplinaire du jeudi soir. Là des médecins, des philosophes, des juristes, des sociologues et bien d’autres sont présents et nous convions souvent un membre de l’équipe soignante à cette réunion, mais rarement un proche jusqu’à présent, estimant que ce serait trop violent. Nous débattons ouvertement de la question qui nous est posée. Puis, nous faisons un compte rendu de notre discussion à chacune des personnes concernées. Nous ne décidons de rien. En fait, nous essayons de désembrouiller un écheveau qui lorsqu’il arrive à nous, mêle de façon souvent devenue inextricable ce qui, relève de l’éthique et ce qui en relève moins, et aussi de hiérarchiser les questions éthiques qui se posent. Souvent, cela suffit à débloquer la situation et permet au dialogue de repartir.
É & C : Si vous ne rendez pas d’avis en bonne et due forme, répondez-vous malgré tout à la question de départ qui vous a été posée ?
V. F. : Bien souvent, tout notre travail consiste à aller au-delà de la question pour laquelle nous sommes appelés et à montrer que le nœud du problème ne se situe pas forcément là où les gens le pensent. Par exemple, une façon de réfléchir autrement au dilemme : oui ou non, est-on arrivé au stade de l’acharnement thérapeutique ? peut consister à se poser la question de savoir qui est le plus légitime pour en décider, du proche ou du médecin. Par ailleurs, le plus important n’est souvent pas de répondre à la question de départ mais de remettre en route le dialogue, pour construire de l’éthique ensemble. C’est le processus qui fait l’éthique pour moi, je n’aime pas l’éthique prescriptive.
É & C : Dans votre pratique d’aide à la décision, qui, en définitive, est légitime pour prendre la décision ?
V. F. : Cela dépend des situations. Mais, effectivement, c’est souvent la question centrale. En tout cas, la problématique n’est jamais de savoir qui a raison ou qui a tort. Quand on nous sollicite, c’est qu’il y a souffrance, tension. À l’origine, souvent il y a usurpation de la prise de décision. Je me souviens par exemple d’un bébé de quelques mois qui était en réanimation pédiatrique. L’équipe considérait qu’il fallait arrêter les traitements, que continuer relevait de la malfaisance. Manifestement l’enfant souffrait, et l’équipe aussi de le faire souffrir. Mais quand les médecins évoquaient avec le père l’arrêt des traitements, il répondait invariablement : « Je ne vous dirai jamais d’arrêter. » Des propos que l’équipe traduisait par : « Je ne veux pas que vous arrêtiez les traitements. » Mais ce n’était pas ce que nous entendions que ce père disait. Pour nous, il exprimait qu’en tant que père, il ne pouvait tout simplement pas prendre cette décision. À un moment donné, nous avons donc dit à l’équipe : « Il nous semble qu’en la circonstance, malgré les droits des patients, c’est à vous de décider, de prendre vos responsabilités et de cesser les soins. » Cela a été un soulagement pour tout le monde.
É & C : L’éthique clinique fait-elle œuvre de démocratie sanitaire ? Si oui, pourquoi selon vous ?
V. F. : Oui, absolument, et ce pour plusieurs raisons. Parce qu’elle ne peut pas être assise sur un rapport d’autorité. Parce que c’est une approche collective, que l’on construit ensemble. Et parce qu’elle est fondée sur le dialogue, le dialogue sur l’éthique, ce qui permet à chacun d’être tiré vers le haut et d’aller chercher le meilleur de lui-même pour dépasser conflits et divergences.
É & C : L’éthique, comme vous la pratiquez, doit-elle être un complément ou quelquefois se substituer au droit lorsqu’il s’agit de situations inédites ?
V. F. : Dans les éléments que nous instruisons, nous faisons toujours référence à ce que dit la loi. Celle-ci fait absolument partie des arguments constitutifs de la réflexion éthique. Et si nous voyons se profiler à l’horizon une décision qui est contraire à la loi, nous devons savoir la repérer. Pour autant, il nous arrive de constater qu’il existe des décisions éthiques qui ne sont pas légales et inversement, c’est-à-dire des prises de position tout à fait en accord avec la loi mais qui peuvent être troublantes au plan éthique. Autrement dit, dans certaines circonstances, transgresser la loi peut se révéler éthique. Rappelons par exemple qu’à une époque il a pu être considéré éthique d’aider certaines femmes à avorter de façon clandestine et illégale. Quant aux situations inédites que vous évoquez, elles sont effectivement assez fréquentes en éthique clinique. Les questions se renouvellent sans cesse, au gré des progrès de la science ou de l’évolution de la demande sociale. En ce moment par exemple, nous sommes confrontés à de nouvelles questions que nous n’avions pas vu venir, concernant le don d’embryon surnuméraire. En effet, la loi autorise depuis quelques années qu’un embryon pour lequel il n’existe plus de projet puisse être donné à un autre couple en mal d’enfant. Afin de vérifier que cet embryon ne présente pas trop de risques génétiques spécifiques, une consultation a été créée pour recevoir les couples à l’origine du don. Mais les généticiens ont du mal à conclure qu’il n’y a pas trop de risques de maladie, il y en a toujours dans les familles… Pour le couple qui était dans une démarche altruiste, c’est violent. On lui dit : ce qui était assez bon pour vous ne l’est pas pour un autre couple !
É & C : Si certains choix éthiques peuvent amener à transgresser la loi, comment peut-on alors se situer entre réflexion éthique et peur d’encourir des poursuites ?
V. F. : Vous savez, beaucoup de mes collègues médecins ne se préoccupent pas vraiment de la loi. Nous ne sommes pas élevés dans cette culture. En revanche, l’éthique fait partie intégrante de notre formation. D’ailleurs, de tout temps, des médecins ont aidé leurs patients à mourir. Ils savaient pertinemment qu’ils transgressaient la loi. Cela fait partie de la grandeur du métier d’être capable de faire de tels choix.
É & C : Y a-t-il un risque, malgré tout, avec l’éthique clinique que celle-ci finisse par instrumentaliser la pratique médicale ? Autrement dit, que cette dernière ne puisse plus être l’apanage du praticien ?
V. F. : Pendant longtemps, on nous a dit que l’éthique clinique allait instrumentaliser les praticiens en les dépossédant de la décision. Mais ce danger n’existe pas. L’expérience le prouve. Vous savez, ceux qui saisissent le centre d’éthique clinique n’ont pas du tout envie d’être dessaisis de leur responsabilité. Ils souhaitent être accompagnés dans leur réflexion et partager les questions qu’ils se posent. Ils restent maîtres de leurs décisions.
É & C : Quelles articulations le CEC peut-il avoir avec d’autres comités éthiques, et notamment ceux œuvrant sur des pathologies précises, et notamment le cancer ?
V. F. : Nous échangeons régulièrement avec d’autres structures d’éthique clinique, notamment étrangères, parce que l’éthique clinique est née aux États-Unis et ne s’est développée que plus tard en Europe. Nous sommes aussi très sollicités par des équipes venant d’autres établissements et qui souhaitent se lancer dans une aventure similaire. Par exemple, je viens d’être appelée par un institut hospitalo-universitaire de neurologie. Ce lieu d’excellence se demande comment intégrer une dimension éthique dans son projet, en tant que démarche transversale, dans laquelle puissent s’intégrer autant les chercheurs fondamentalistes que ceux en charge des soins quotidiens aux malades. C’est une bonne chose. Il y a enfin d’autres structures qui travaillent sur des sujets particuliers, comme les comités d’éthique de certaines sociétés savantes, les sociétés de réanimation, par exemple, ou le comité d’éthique de la Ligue contre le cancer, dans lequel travaillent plusieurs membres de notre groupe d’éthique clinique. Il me semble que cette prolifération ne nuit pas, bien au contraire. Elle signale une préoccupation et un besoin plutôt rassurants…
Ce qu'il faut retenir:
texte