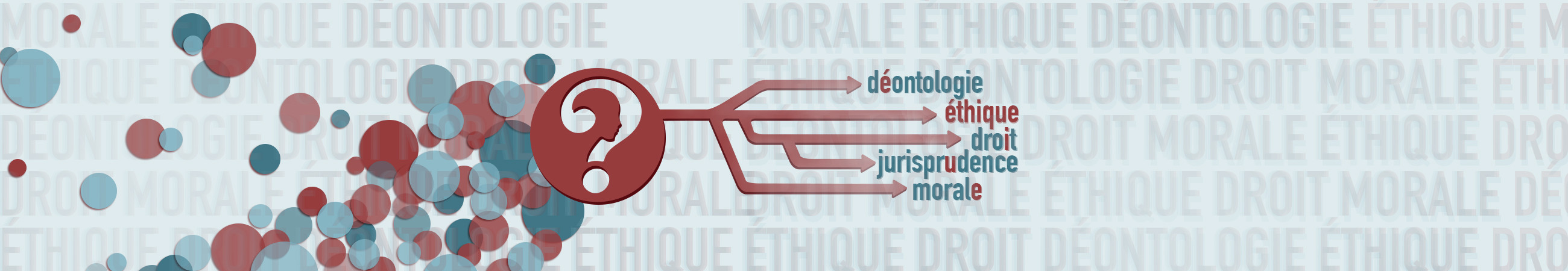L’expérimentation animale et ses enjeux moraux
L’expérimentation animale est un ensemble de procédures qui visent à mieux comprendre le fonctionnement des organismes vivants et notamment à produire des outils thérapeutiques, comme des médicaments. Comme elle repose sur l’utilisation d’animaux vivants, en grande majorité des rats et des souris, elle suscite des objections morales quant à sa légitimité. La majorité de la population accepte tacitement cette pratique, qu’elle finance par ses impôts. Un petit nombre d’opposants radicaux, qui devraient eux-mêmes ne jamais prendre de médicaments, préfèrent parler de « vivisection », un terme plus « chirurgical » et plus polémique, et se qualifient alors d’ « antivivisectionnistes ». Au sein de ce débat, comment situer l’expérimentation animale d’aujourd’hui face à la réflexion morale ?
Dans nos sociétés occidentales, fondées sur les lois, on tend exprimer de plus en plus le respect des animaux en termes de « droits de l’animal », des droits philosophiques, conçus par les êtres humains en faveur d’individus d’autres espèces, et qui peuvent ensuite être transcrits dans la loi pour imposer des contraintes, même à ceux des humains qui ne se soucient pas des animaux. Des textes protègent déjà individuellement les animaux domestiques ou sauvages tenus en captivité contre les maltraitances, ainsi que les effectifs des populations de certaines espèces sauvages vivant à l’état de liberté et menacées d’extinction. En ce qui concerne l’expérimentation animale, des mesures visent à protéger contre la douleur les animaux vertébrés, certaines de leurs formes embryonnaires (avec quelques incohérences, puisque les embryons de mammifères sont protégés alors que ceux des oiseaux d’âge comparable ne le sont pas), ainsi que les mollusques céphalopodes, comme les pieuvres, reconnus aptes à ressentir la douleur[1].
Une justification sur le fond
Les animaux détenus par l’homme sont reconnus en France par le code rural depuis 1976 comme des « êtres sensibles », ce qui, dans les faits, ne change pas grand-chose[2], compte tenu des innombrables dérogations qui permettent de leur causer de la douleur (expérimentation animale, mais aussi élevages industriels, transports et abattages, jeux cruels comme la chasse ou la course de taureaux, etc.). Néanmoins, face à cette reconnaissance des animaux comme « êtres sensibles », comment justifier, sur le fond, l’expérimentation qui les utilise ?
Les droits de l’animal peuvent entrer en conflit avec des droits fondamentaux de l’espèce humaine[3] - droits à la vie, droits à la santé (Soulignons qu’il s’agit bien ici des droits fondamentaux : le « droit de chasse », par exemple, n’est évidemment pas un droit fondamental). Dans un cas extrême, lors d’un conflit entre un prédateur animal et un être humain, certes le prédateur animal a le droit de manger pour vivre, mais il reste que l’espèce humaine a le droit de défendre en priorité le « droit à la vie » d’un de ses membres et de porter assistance à celui-ci, au détriment du prédateur animal. D’une manière analogue, même si les rongeurs de laboratoire n’ont pas « demandé » à servir à des expériences, lorsqu’un conflit de droits existe entre les droits du rongeur à une vie exempte de douleurs causées par les humains et les droits de l’homme à améliorer la santé, l’espèce humaine, comme toute autre espèce animale, défendra d’abord ses droits fondamentaux propres, et pratiquera l’expérimentation animale, tant qu’aucune solution de remplacement systématique ne pourra être trouvée.
Quels droits pour les animaux ?
Cette notion pragmatique de « conflit de droits » et de respect privilégié des droits de l’homme lorsqu’ils apparaissent comme des droits fondamentaux est cohérente avec la déclaration universelle des droits de l’animal. On sait qu’existent plusieurs conceptions différentes des droits de l’animal. Selon les conceptions les plus radicales, il n’y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne la protection contre la douleur, les animaux ou les humains. C’est, par exemple, la position défendue par Tom Regan[4]. Mais ce point de vue rencontre une grave objection : il ne concerne, selon l’auteur, que « les mammifères âgés d’un an ou plus », ce qui est une étrange limitation de la notion d’animal. On peut formuler la même objection au projet « grands singes »[5], qui vise, pour les protéger efficacement, à donner certains droits de l’homme à nos proches cousins les grands singes. Il est certes impératif de protéger les mammifères en général et les grands singes en particulier, mais on ne voit pas pourquoi alors d’autres animaux (les oiseaux, les autres vertébrés, les pieuvres, etc.) échapperaient aux mêmes droits.
La meilleure expression des droits de l’animal est celle de la déclaration universelle des droits de l’animal, dans sa version la plus récente de 1989[6]. Elle définit des droits pour les animaux en tenant compte des spécificités et des besoins de leur espèce (les conditions de bien-être de l’abeille ne peuvent pas être celles du chimpanzé) et du respect des équilibres biologiques (quand il n’est pas lui-même menacé, l’homme n’a pas à intervenir dans un conflit entre un prédateur et sa proie). En ce qui concerne l’expérimentation animale, la déclaration constate, dans son article 6, que celle-ci « viole les droits de l’animal » et que « des méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre ».
Des améliorations ponctuelles et ouvertes vers le futur
Dire que des méthodes de remplacement doivent être développées, c’est aussi reconnaître la nécessité de l’expérimentation animale tant que ces méthodes ne sont pas utilisables. Si, dans l’état actuel de la société, pour continuer à étendre des connaissances comme à améliorer les pratiques thérapeutiques, l’expérimentation animale paraît incontournable, quelles améliorations concrètes peut-on concevoir pour la rendre mieux compatible avec les droits de l’animal ?
D’abord l’ensemble de la biologie expérimentale sur des animaux vivants est guidée par la célèbre « règle des trois R » de Russell et Burch[7] : Réduire, Raffiner, Remplacer. C’est-à-dire :
- réduire le nombre d’animaux utilisés par expérience au minimum nécessaire et suffisant pour trouver une réponse, en évitant les expériences aux résultats triviaux ou déjà effectuées ailleurs dans le monde, en utilisant une planification statistique appropriée ;
- raffiner les protocoles expérimentaux, afin qu’ils soient les moins contraignants ou/et les moins douloureux qu’il est possible, notamment par la pratique systématique de l’anesthésie en cas de chirurgie ;
- remplacer les expériences sur les animaux entiers par des méthodes alternatives, lorsque cela s’avère possible, car il faut rappeler que ce n’est pas toujours possible. Les modèles alternatifs fondés sur les études moléculaires, cellulaires ou tissulaires, ou encore sur les simulations informatiques, ne peuvent pas donner de réponse sur le fonctionnement de l’organisme entier. Pour savoir, par exemple, si une molécule fait dormir, ou quelles sont les répercussions d’une thérapie sur l’état hormonal dans son ensemble, ces modèles partiels ne peuvent suffire. Et les données cliniques chez l’homme ne permettent pas de cerner les effets d’un médicament nouveau, dont la toxicité n’a pas encore été étudiée.
Outre cette « philosophie générale » de la règle des trois R, de nombreuses mesures visent en France à améliorer le déroulement des expériences et la vie des animaux utilisés. Un contrôle est exercé sur la qualité des animaleries pour qu’entre les expériences, les animaux aient une vie paisible. Des formations sont exigées des futurs expérimentateurs, pour s’assurer qu’ils ont la compétence technique et la sensibilité morale nécessaires. Enfin une « Charte nationale portant sur l´éthique de l´expérimentation animale » a été récemment élaborée[8], sous la double égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de celui de l’Agriculture et de la Pêche. Cette charte vise à « mailler » tout le territoire national de comités d’éthique adhérant aux principes moraux qu’elle énonce, comités qui, en liaison avec les ministères concernés, surveilleront alors chaque projet comportant des procédures expérimentales utilisant des animaux vivants vertébrés ou céphalopodes, que tout chercheur doit soumettre à autorisation.
Certes, de nombreux progrès restent encore nécessaires. Les banques internationales de données, qui permettraient d’éviter de refaire des expériences identiques, sont insuffisantes. Les méthodes alternatives sont très insuffisamment encouragées. Les formations des futurs expérimentateurs restent très incomplètes sur le plan moral. Et les comités d’éthique adhérant à la « charte », qui sont mis en place, ont un rôle décisionnaire, mais non disciplinaire… Mais l’esprit de la Règle des trois R laisse la porte ouverte à des améliorations ultérieures.
Conclusion
Revenons à notre question de départ. Si l’on veut situer l’expérimentation animale d’aujourd’hui face à la réflexion morale, la solution proposée est de pratiquer l’expérimentation quand elle s’avère nécessaire aux progrès de la connaissance, de la médecine humaine, de la médecine vétérinaire, mais en veillant à l’associer à des mesures qui limitent, sans pouvoir parfois les supprimer, les effets négatifs sur les animaux. Lorsque l’expérimentation animale oppose deux impératifs moraux contradictoires, celui d’améliorer la santé humaine et celui de respecter les animaux, la solution proposée est une combinaison très imparfaite de ces deux impératifs contradictoires.
Le moraliste puriste sera évidemment déçu. En morale pratique, les solutions sont rarement en « tout blanc » ou « tout noir ». Ainsi le délai arbitraire admis pour l’avortement humain ne satisfait parfaitement ni les partisans, ni les opposants à cette pratique. Il en est de même des critères de l’euthanasie. Le choix de privilégier la santé humaine face aux droits de l’animal est de cette nature. Certes le souci grandissant des droits de l’animal dans nos sociétés, et les améliorations ponctuelles que nous avons évoquées, amèneront sans doute à une amélioration progressive du traitement des animaux d’expériences et, finalement, à une réduction, à terme, de la place de l’expérimentation au sein de la recherche biologique et biomédicale, sans que l’on puisse, pour le futur proche, concevoir une utopique société humaine, où toute expérimentation sur l’animal serait abolie. Aujourd’hui, il nous faut évoluer vers davantage de respect des droits de l’animal, sans pour autant oublier la nécessité morale impérative d’améliorer, au nom des droits de l’homme, la santé humaine.
[1] Auffret Van der Kemp T., Lachance, M. (Sous la direction de), La Souffrance animale : de la science au droit. Éditions Yvon Blais, Cowansville, Québec, Canada, 2013.
[2] Chapouthier G., « L’Éthique animale, entre science et droit » in Pour la Science, 2014 : 440 : pp.11-12.
[3] Chapouthier G., Nouët JC. (Sous la direction de), Les Droits de l’animal aujourd’hui, Arléa-Corlet-Ligue française des droits de l’animal, Paris, 1997.
[4] Regan T., Les Droits des animaux, Hermann, Paris, 2013.
[5] Singer P., Cavalieri P., The Great Ape Project : Equality Beyond Humanity, Fourth Estate publishing, London, 1993.
[6] Coulon J., Nouët JC. Les Droits de l’animal, Dalloz, Paris, 2009.
[7] Russell WMS., Burch RL. The Principles of Humane Experimental Technique, Methuen, London, 1959.
[8] Chapouthier G., Tristani-Potteaux F., Le Chercheur et la souris : La Science à l’épreuve de l’animalité, CNRS Éditions, Paris, 2013.