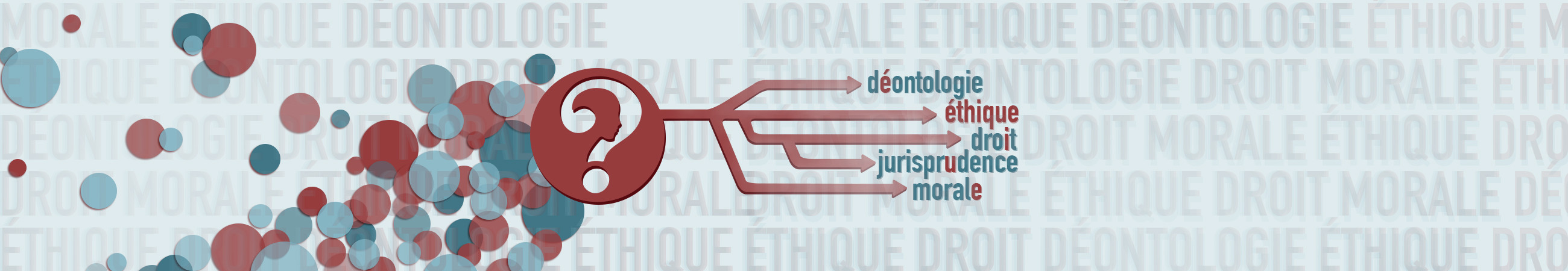Le médecin généraliste a sa place à toutes les étapes de l’accompagnement du patient
Acteur majeur du suivi des malades, le médecin généraliste de par sa proximité avec le patient est généralement désigné comme le médecin de famille, à savoir celui qui veille à la santé du foyer. Aujourd’hui, le médecin généraliste ne peut plus être cantonné à cette définition quelque peu désuète. Confronté à l’évolution continue de la médecine et des différentes disciplines afférentes, il doit sans cesse renouveler son savoir et son savoir-être face à des usagers de plus en plus concernés par leur santé.
Propos recueillis par Laurent Pointier
Éthique & Cancer : Y a-t-il des valeurs morales spécifiques qui doivent guider l’exercice de la médecine générale ?
Isabelle Aubin-Auger : Je ne pense pas qu’il y ait de valeur morale qui soit spécifique à la médecine générale. On retrouve les mêmes valeurs morales dans l’ensemble des spécialités. Chacun dans son exercice doit être guidé par des notions telles que le respect de l’individu ou l’éthique en matière de ressources financières disponibles notamment sur les honoraires demandés au patient. Il me semble donc crucial de pouvoir mener des actions qui ne soient pas contraires au bien de mes patients et qui ne répondraient pas à la quête d’un enrichissement financier personnel. Concrètement, il s’agit de faire le bien pour autrui de manière désintéressée.
É & C : L’annonce d’un cancer constitue toujours un traumatisme pour la personne malade. Le dispositif d’annonce, l’une des mesures phares du Plan cancer 2003-2007, a eu pour objectif de permettre à la personne malade de bénéficier des meilleures conditions d’information, d’écoute et de soutien. En votre qualité de médecin généraliste, pensez-vous être un interlocuteur privilégié pour la personne malade ?
I. A-A. : Oui, de manière claire et certaine. Si l’annonce a été verbalisée par un spécialiste à l’issue d’une coloscopie ou d’une radio par exemple, le médecin généraliste se retrouve alors en deuxième ligne pour accompagner le patient dans ses démarches administratives mais aussi quelquefois pour reformuler les explications qui lui ont été données. Parce que le médecin généraliste et le patient sont souvent dans une relation de confiance de longue date, ce dernier se sent légitime à demander une validation de la part de son médecin traitant. Même lorsque le patient entre dans un circuit de soins spécialisés, nous avons le souci constant d’être à ses côtés pour l’accompagner sur les plans physique et moral. En définitive, le médecin généraliste a sa place à toutes les étapes de l’accompagnement du patient et plus particulièrement à l’occasion du dispositif d’annonce. Il arrive parfois au médecin généraliste d’être en carence d’information ou de compte-rendu de la part de l’hôpital voire de ne pas pouvoir joindre le spécialiste pour obtenir des avis. La relation entre la médecine de ville et la médecine hospitalière est alors complexe, ce qui n’est pas sans conséquence pour le patient.
É & C : Peut-on donc affirmer que le médecin généraliste n’est pas suffisamment associé au parcours de soins ?
I. A-A. : C’est très variable. En théorie, le médecin généraliste devrait pouvoir assister aux réunions de concertation pluridisciplinaire lorsqu’une décision importante doit être prise pour le patient. Pour ma part je pense n’y avoir jamais été conviée, et encore faudrait-il pouvoir le faire en pratique puisque nous avons les uns et les autres des emplois du temps surchargés. On peut effectivement regretter le fait de n’être pas concertés en amont de la décision sachant que le médecin généraliste dans sa relation privilégiée avec le patient apporterait certains éléments nécessaires à la prise de décision. Au-delà des traitements initiaux, pour lesquels nous ne sommes pas consultés, le médecin généraliste peut avoir un rôle à jouer s’agissant des chimiothérapies de deuxième ou de troisième ligne. En effet, le patient éprouve des difficultés à dire non parce qu’il est pris dans un parcours de soins qui le dépasse. Or nous savons qu’en concertation et avec l’aval de son médecin généraliste il souhaiterait pouvoir interrompre ces soins qui causent souvent plus d’effets secondaires qu’ils n’apportent de bénéfices. Je pense que dans de telles circonstances, on ne prend pas suffisamment notre avis.
É & C : Le choix thérapeutique doit-il relever d’une décision unilatérale du spécialiste ou être concerté avec le médecin généraliste mais aussi avec la personne malade ?
I. A-A. : Dans l’idéal, la concertation à trois serait très bien. Mais j’ai le sentiment que ce n’est pas toujours le cas. Il faudrait que le médecin généraliste puisse être éventuellement consulté avant que les décisions ne se prennent. Même si nous n’assistons pas physiquement aux réunions, il existe aujourd’hui des moyens de communication nous permettant de prendre des décisions communes en amont pour que le choix thérapeutique soit le moins mauvais possible pour le patient. J’ai en tête le cas de patients en fin de vie qui avaient des difficultés à dire au cancérologue qu’ils préféraient interrompre la chimiothérapie afin de recouvrer une qualité de vie pour leurs derniers moments. On pourrait éviter ce type de quiproquo dans le cadre d’une concertation entre les différentes personnes intéressées.
É & C : L’éthique doit-elle intégrer les programmes de formation médicale continue des futurs médecins généralistes ?
I. A-A. : Oui, bien sûr. Nous disposons d’un programme dans le développement professionnel continu qui va dans ce sens. Il y a deux ans de cela, j’ai également assisté au congrès général de la médecine, il y avait une thématique sur l’éthique et sur la fin de vie, preuve de la part grandissante que prend cette réflexion au sein de notre exercice. Il serait souhaitable que ces formations soient généralisées. Mais il faut garder à l’esprit qu’on choisit ses programmes de formation en fonction de ses affinités. Il reste donc difficile d’imposer aux futurs médecins généralistes de suivre des formations spécifiques à l’éthique. J’ai pu cependant constater en ma qualité d’enseignante en troisième cycle de médecine générale à la faculté Paris Diderot (Bichat-Lariboisière), qu’une large place est faite à la communication, à la relation médecin-patient. Nous travaillons également sur des projets de recherche avec d’autres partenaires, notamment des sociologues. Il me semble que la médecine générale est davantage sensibilisée à ce volet sciences humaines de la médecine que d’autres disciplines qui restent dans le domaine purement biomédical. Résolument, nous insistons sur une approche centrée sur le patient plutôt que sur une approche centrée sur la pathologie.
É & C : L’information médicale auprès du grand public va en s’accroissant. Les annonces spectaculaires y sont nombreuses. Pour être déontologique, l’information médicale au patient sur son cancer doit être précise et accessible. Face à l’abondance d’informations (spécialistes, amis, Internet, etc.), le rôle du médecin généraliste est-il aussi de rendre intelligibles les propos du cancérologue ?
I. A-A. : Je ne sais pas si c’est le rôle du médecin généraliste mais c’est souvent le cas dans la pratique. Les raisons sont multiples : les cancérologues sont à la fois débordés et proposent de ce fait des consultations très courtes ; les patients au moment de l’annonce sont sidérés et ne sont pas toujours en mesure de comprendre les propos du cancérologue voire ne veulent pas les entendre. C’est l’intérêt d’avoir un acteur que je qualifierai de deuxième ligne, à savoir le médecin généraliste, qui reformule en ayant une approche plus centrée sur le patient en partant de ce que ce dernier a compris pour définir avec lui quelles sont ses représentations, quelles sont ses craintes par rapport à la maladie. Sans stigmatiser les pratiques d’écoute ayant lieu à l’hôpital, le médecin généraliste et le patient ont l’avantage de se connaître réciproquement dans un rapport de confiance où les rôles de chacun sont bien définis. C’est tout l’intérêt de l’approche centrée sur le patient mise en œuvre par la professeure Moira Stewart[1] qui remet en cause l’approche unidirectionnelle du médecin vers le patient. Cette approche est également en opposition à l’approche centrée sur la maladie. Une des composantes de cette approche centrée sur le patient est de définir les rôles de chacun afin de clôturer le dialogue en définissant des objectifs précis en accord avec le patient, ce qui améliore la satisfaction du patient et favorise son adhésion aux propos tenus par le médecin généraliste et éventuellement au traitement.
É & C : Il existe des facteurs de risque parfaitement connus tels que le tabac ou l’alcool dans la survenue de certains cancers. Quels peuvent être les mots du médecin généraliste pour délivrer une information efficace sans effrayer ?
I. A-A. : Pour délivrer ce que nous appelons le conseil minimal, il faut identifier le facteur de risque, ce que le médecin généraliste ne fait pas toujours. Si pour la consommation de tabac, le dialogue entre le médecin et son patient se déroule sans tabou, il n’en va pas de même pour la consommation d’alcool. Pour avoir assisté à des groupes de parole qui réunissaient d’anciens buveurs, j’ai constaté qu’il fallait même un certain temps pour que le médecin aborde avec son patient son éventuelle consommation d’alcool. Ainsi, la plupart des dossiers médicaux sont plus facilement renseignés pour le tabac que pour l’alcool. Ensuite, il faut savoir où se situe le patient dans le cycle de Prochaska[2] afin d’engager une démarche active et efficiente qui ne risque pas d’être délétère si le patient ne se sent pas concerné par la question. Les médecins généralistes ont l’avantage d’être dans une démarche au long cours, ce qui leur permet de sensibiliser régulièrement leurs patients. Enfin, d’autres moyens existent pour concerner le patient sur les risques futurs de sa consommation, notamment en contournant le risque cancer qui demeure un tabou et en évoquant avec lui les risques de maladies cardiovasculaires mais aussi en axant un discours sur le coût financier de leur consommation, notamment chez les jeunes pour lesquels les arguments médicaux ne prédominent pas. Faire peur au travers de la maladie n’est pas forcément un argument qui va fonctionner.
É & C : Les campagnes de prévention n’excluent-elles pas trop souvent les populations précaires et peu sensibilisées, qui consultent peu ?
I. A-A. : Il est nécessaire d’activer d’autres leviers. Les arguments financiers pourraient jouer ici de tout leur poids, à savoir que les dépenses liées à leur consommation d’alcool ou de tabac pourraient être investies dans des médicaments d’aide au sevrage qui leur seraient remboursés et leur feraient économiser de l’argent. Mais nous sommes confrontés à un double problème : c’est une population que nous voyons peu dont la priorité n’est pas nécessairement d’arrêter de fumer. Par ailleurs, les mesures d’augmentation du prix du tabac ont peu de prise sur ces populations qui ont souvent recours à l’économie parallèle pour s’approvisionner ou encore à l’achat à l’étranger de cartouches de cigarettes. On peut en tout état de cause regretter de ne pas être plus incitatif sur le plan de la prise en charge du sevrage.
É & C : La généralisation des programmes de dépistage de certains cancers est relativement récente. Ils peuvent être perçus comme une procédure anxiogène engagée vers une population n’ayant formulé aucune demande : comment les promoteurs des programmes de dépistage pourraient-ils procéder pour les faire accepter dans le respect du principe de non-malfaisance ?
I. A-A. : Pour certains dépistages, on fait effectivement basculer les personnes d’un statut de non-malades qui n’avaient rien et ne demandaient rien à un statut d’éventuels futurs malades. Nous n’insistons pas assez, en particulier pour les dépistages du cancer du col de l’utérus et du cancer du côlon, sur le fait qu’il s’agit de rechercher des anomalies avant même l’apparition d’un cancer. Contrairement au dépistage du cancer du sein, on a la chance de pouvoir intervenir sur des lésions précancéreuses (dysplasies pour le col de l’utérus ou polypes pour le côlon), or cela n’est pas suffisamment dit. Il y a ici une argumentation qui est sous-utilisée, il serait plus juste de dire que ces dépistages permettent de court-circuiter la survenue d’un cancer dans une quinzaine d’années, c’est une vraie chance.
[1] Le Pr Moira Stewart est titulaire d’une chaire de recherche au Centre d’études en médecine de famille à l’university of Western Ontario au Canada. Depuis ces trente dernières années, elle dirige la recherche sur les services en soins de premier recours et sur la communication entre patients et professionnels de la santé. Elle est l’auteure, en collaboration avec Judith Belle Brown et Thomas R. Freeman, d’une série internationale de livres qui appliquent la méthode clinique centrée sur le patient.
[2] Le cycle de Prochaska théorisé en 1977 par James O. Prochaska, professeur de psychologie et directeur du Centre de recherche de la prévention des cancers à l’université de Rhode Island, comporte 6 étapes dans le changement du comportement : la pré-intention, l’intention, la préparation, l’action, le maintien et la résolution.