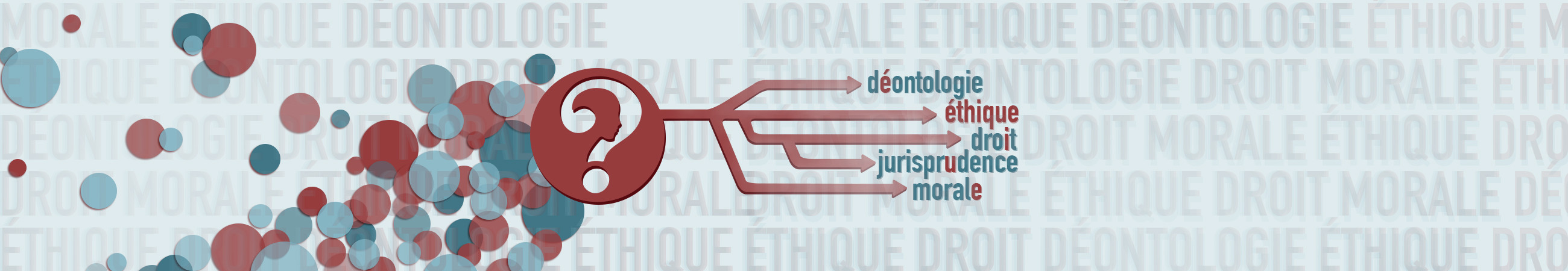Le mensonge médical peut-il être une valeur éthique ?
Dans les relations entre le soignant et le patient, le mensonge fascine et effraie toujours autant. Il conduit immanquablement à s’interroger sur la notion de vérité qui, en réalité, doit être tempérée par le doute et l’incertitude. La frontière entre cette vérité et le mensonge est donc ténue. Est-ce parce que les patients ne sont pas en mesure d’entendre la vérité que les médecins ont justifié le recours au mensonge ? En définitive, le mensonge protège-t-il le médecin ou son patient ?
Ce titre volontairement provocateur peut laisser perplexe. Il a cependant un avantage : celui de traduire des difficultés rencontrées par des soignants mal préparés à délivrer de « mauvaises nouvelles ». Il y a tant à dire sur le déclin du mensonge médical que je présenterai seulement quelques éléments de discussion, en laissant chacun y apporter ses nuances. Mais je veux affirmer d’emblée que le mensonge n’est jamais souhaitable et qu’il n’est qu’exceptionnellement possible de s’affranchir de cette règle.
Quelques repères historiques
Pour Platon, le mensonge est condamnable, sauf en médecine. Pour Kant, mentir est manquer de respect à la personne à qui l’on ment, que l’on trompe délibérément ; c’est aussi se manquer de respect à soi-même. Encore plus que d’autres, les patients doivent être respectés ; et on ne saurait imaginer des soignants qui ne se respectent pas. En 1910, le médecin américain Richard Cabot recommande de ne pas mentir pour deux raisons : pour lui, les malades sont capables d’entendre la vérité, aussi désagréable soit-elle pour eux ; le mensonge est « contagieux » : on ment au malade en disant la vérité à un proche qui saura à quoi s’en tenir quand il sera malade à son tour. Il faudra presque un siècle pour que cela soit reconnu.
À la fin du XXe siècle, les mentalités ont profondément changé : après les femmes, les peuples colonisés, les enfants… les personnes malades s’émancipent également. Si parfois la maladie fait régresser et peut infantiliser, les soignants n’ont pas à accentuer cette tendance. Ils sont là, au contraire, pour la corriger, pour rétablir, dans toute la mesure du possible, l’autonomie des personnes : elle est un élément essentiel de leur bien-être physique, mental et social, si l’on suit la définition de la santé par l’OMS[1] et le modèle bio-psycho-social de la médecine qui en découle.
La loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale prescrit leur information précise. On peut remercier Claude Huriet pour cette loi qui a obligé les médecins à informer exactement un patient dans des conditions particulièrement difficiles : son application a prouvé que c’était possible et, à mon sens, elle a apporté autant à l’information des patients qu’à la recherche médicale. Suivant le code de déontologie médicale de 1995, le médecin doit au patient qu’il soigne ou conseille « une information loyale, claire et appropriée ». Comment a-t-on pu si longtemps apporter et défendre une information déloyale ? Que serait le consentement éclairé auquel a droit tout individu – pas seulement en médecine – sans un éclairage correct ?
À la fin des années 1990, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts en faveur d’une information complète et authentique, admettant une seule restriction : le médecin peut retenir une information s’il est assuré – et écrit dans l’observation médicale des indices précis dans ce sens – que l’information sera nuisible au patient (Primum non nocere[2]). La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a fait de cette information un devoir légal – qui ne laisse évidemment place à aucune tromperie – pour tous les professionnels de santé. Le malade a le droit de refuser toute information, ce qui contraint à un mensonge par omission, au moins temporaire. Ni le législateur ni le juge ne peuvent être suspectés d’ignorer l’éthique.
Mensonge versus vérité
Contraire à la vérité, le mensonge conduit à s’interroger sur cette vérité. En médecine, elle est souvent tempérée par le doute, l’incertitude. Celle-ci est inconfortable pour le médecin, mais il gagnerait à ne pas croire qu’il détient une quelconque « vérité ». L’incertitude n’est pas propre à la médecine, elle baigne toute la société dans la vie courante, familiale, professionnelle, sportive, politique, etc. Elle peut être partagée. Et « le doute est libérateur ».
Pour un cancer, cette vérité s’impose exceptionnellement d’un coup, en bloc. En réalité, elle est fragmentée, progressive : on suspecte, on cerne, puis on affirme un diagnostic de malignité ; le bilan préthérapeutique en précise ensuite la gravité, la possibilité de guérir ou les difficultés pour traiter ; enfin, la réponse au traitement, prévisible mais jamais assurée, représente le facteur pronostique le plus déterminant. Cela demande quelques jours ou quelques semaines. Devrait-on mentir à certains moments, et auxquels ? A-t-on jamais montré que la vérité était durablement et dramatiquement toxique ? On ne peut retenir quelques suicides colportés comme de fausses preuves. Il faut plutôt suivre Dante : « Si au premier goût ta parole est amère, elle dispensera, une fois digérée, un aliment de vie. » Le médecin ne peut plus être considéré comme un « menteur bienfaisant ». Rejetant le « mensonge charitable » traditionnel, il doit apporter une parole vraie et aider à la digérer.
« Mauvaise nouvelle » pourrait presque être un pléonasme. Tout changement dérange, de façon variable selon les individus : c’est le malade qui fait la nouvelle mauvaise. Non rarement, ce que le médecin croit être une bonne nouvelle est mal reçu ou, inversement, une information a priori désagréable est un soulagement pour le malade qui s’attendait à pire. Tandis que pour un médecin un diagnostic de métastase, dans la majorité des cas incurable, est plus grave que le diagnostic initial de cancer, c’est plutôt l’inverse pour un malade : il est dramatiquement surpris par le diagnostic initial alors que le plus souvent, il sait à quoi s’en tenir avant même les manifestations d’une rechute et n’est plus surpris au moment où survient celle-ci dont il sait à l’avance la gravité qu’elle représente.
On ne s’éloigne jamais de la réalité sans risque et les méfaits du mensonge sont irréfutables, qu’on se place du point de vue du médecin ou de celui du patient. Le médecin menteur perd la confiance de la personne malade – qui n’a souvent aucun mal à suspecter la tromperie, alors qu’elle a besoin d’avoir confiance en celui ou celle qui le soigne – quand il ne se déconsidère pas. L’ambiance de mensonge rompt l’authenticité et corrompt la relation, entre malade et soignant, mais aussi entre le patient, censé ne pas savoir, et ses proches à qui on laisse croire qu’ils « savent ». Qu’il lui soit délivré par un soignant ou qu’il s’en persuade lui-même, le mensonge prive le malade des repères qui lui sont utiles, sinon indispensables pour s’adapter à la réalité : ne pas engager des projets irréalistes, qui ne pourraient qu’être déçus et que des successeurs auraient du mal à régler ; prendre des dispositions pour faire respecter ses « dernières » volontés, favoriser le processus de deuil de ses proches.
Comment soigner un malade sans lui dire de quoi il souffre, en restant dans le vague, en l’inquiétant : comment ce médecin peut-il me soigner alors qu’il a l’air de ne pas savoir ce que j’ai ? Un danger inconnu, « innommable », est plus redouté qu’un danger identifié, aussi redoutable soit-il. La plupart des individus menacés souhaitent savoir contre quoi se battre. Sauf pour certains traitements psychotropes, il est devenu impensable, plus qu’illégal, de soumettre un patient à un essai thérapeutique sans l’en informer, complètement. De façon plus courante et pragmatique, indiquer les effets toxiques d’un traitement, qui peuvent faire hésiter, permet de mieux les éviter ou d’en réduire les conséquences.
En pratique
Parfois, c’est le malade qui commande ou du moins qui guide. Le médecin ou tout autre soignant n’a pas à juger à sa place, en une démarche de substitution qui peut friser l’usurpation. Cela n’impose pas de faire exactement ni toujours ce que le patient demande. Le médecin doit savoir reconnaître quand l’autre prêche le faux pour savoir le vrai, ou détecter qu’une personne ingénue ne se doute pas de la vérité explosive qui lui pend au nez et risque de la ravager. Il faut toujours commencer par rejeter la tromperie et partir du souci de franchise, sans pour autant prétendre ou chercher à se libérer sans tact ni mesure.
Si dire la vérité est souhaitable sinon nécessaire, quand et comment la dire est autrement compliqué. « Que faut-il dire à un malade ? Il faut le lui demander », disait le physicien Jay Katz. Pour cela il faut savoir l’écouter et, le cas échant, savoir le faire parler. Il s’agit d’évaluer ce qu’il sait ou croit savoir, ce dont il se doute, ce qu’il appréhende ou craint, ce qu’il est prêt à entendre et comment, ce qu’il accepte et ce qu’il refuse, y compris d’entendre.
Le cancer est omniprésent dans notre société et on voit mal comment quelqu’un tombant malade pourrait ne pas suspecter en être frappé. Les médecins savent combien souvent la personne qui vient les consulter a fait elle-même son diagnostic, éventuellement de façon abusive ou inexacte. On peut, si et quand elle demande ce qu’elle a, lui retourner la question : qu’en pense-t-elle elle-même ? Elle a des sources d’information internes qui ne la trompent pas plus que ce que risque de dire le médecin. Les malades en savent beaucoup plus que ce qu’on leur prête a priori et on leur fait parfois plaisir en leur confirmant qu’ils avaient raison, aussi désagréable que soit cette confirmation. Sans perdre espoir – mais l’espoir de survivre laisse la place à beaucoup d’autres espoirs, y compris celui de ne pas être trompé –, elle se doute bien que sa vie est bornée. Il arrive alors que ce soit elle qui prononce le diagnostic, aussi malvenu et indésirable qu’il soit. Quand le médecin découvre ce que le malade sait ou dont il se doute, ce qu’il a à lui dire est souvent très simplifié. Il faut rectifier et, pour cela, l’écouter.
Sans laisser les choses traîner en longueur, on parlera au fur et à mesure que des informations arrivent, en ne cachant pas les incertitudes, en répondant aux attentes du patient, en lui laissant le temps de les métaboliser, en l’aidant à faire face aux difficultés qui l’attendent vraiment.
1 Cette définition est celle du préambule de 1946 à la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette définition de l’OMS n’a pas été modifiée depuis 1946.
2 Primum non nocere est une locution latine qui signifie : « d’abord, ne pas nuire ». C’est un des principaux préceptes appris aux étudiants en médecine. Son origine est incertaine. La plus ancienne trace de son principe se trouve dans le traité des Épidémies (I, 5) d’Hippocrate, daté de 410 av. J.-C. environ, qui définit ainsi le but de la médecine : « Avoir, dans les maladies, deux choses en vue : être utile ou du moins ne pas nuire. »
Notice bibliographique
Hœrni B., Bénézech M., La Relation humaine en médecine. Ses mutations en France, 1947-2002. Paris, Glyphe, 2010, où l’on pourra trouver de plus amples développements (en particulier p. 179-196) ainsi que beaucoup de renvois à des ouvrages ou à des articles concernant cette question.