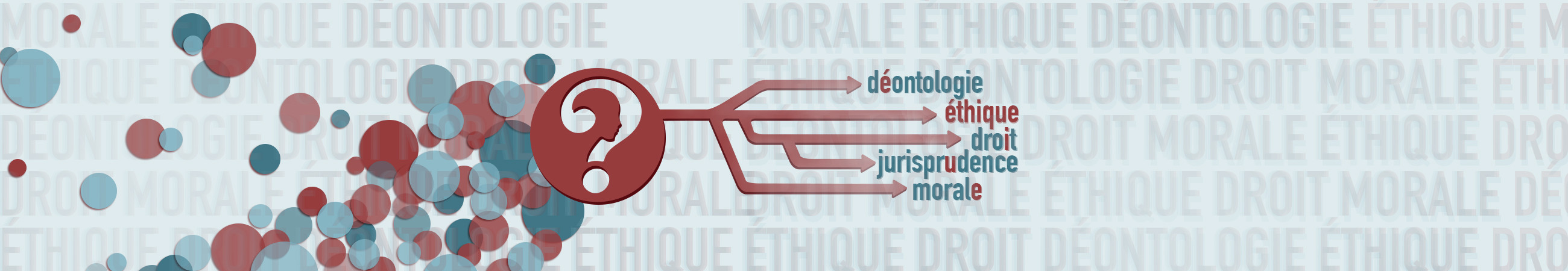Pour une éthique des soins en situation interculturelle
L’hôpital accueille l’ensemble des patients, indépendamment de leur origine ou de leurs références socioculturelles. À la méconnaissance des codes médicaux qui peuvent s’avérer anxiogènes s’ajoute l’appréhension d’être plongé au milieu d’un groupe à l’identité exogène (langue, culture, religion). Ce lieu où s’effacent les singularités soulève le problème d’être pris en charge et soigné dans le respect de l’identité propre du patient. Dans quelle mesure l’hôpital doit-il s’adapter aux références socioculturelles du patient et en retour le patient en situation d’interculturalité a-t-il l’obligation de se soumettre aux exigences que requiert ce lieu de soins ?
Le monde est toujours le fait de l’interprétation d’un acteur puisant avec sa singularité dans la boîte à outils de ses références sociales et culturelles. Avec les nuances propres aux classes sociales, aux références culturelles, aux histoires personnelles, au fait d’être un homme ou une femme, jeune ou âgé… les significations plus ou moins partagées au sein d’un groupe délimitent un univers de comportements connus, elles classent les objets en catégories compréhensibles et inépuisables pour ceux qui connaissent les codes. Même si toute signification est affaire de contexte, chacun acquiert dès l’enfance la faculté de passer du particulier au général pour attribuer une signification à un fait. En élaborant la signification de sa conduite l’individu est aussi élaboré par elle. Le lien social découle de ce processus permanent. Mais les individus ne vivent pas toujours dans les mêmes dimensions du réel, ils s’inscrivent dans des mondes sociaux, des provinces de significations susceptibles d’aboutir à des conflits d’interprétation.
Entre savoir médical et discours profane
La maladie est un fait naturel et biologique pour les médecins, et la trame de sens qui l’enveloppe pour les patients est perçue comme une série de préjugés et une ignorance à dissiper. Une sorte de vérité médicale de la maladie viendrait s’opposer aux fantasmes à son égard (Good, 1999). Le débat autour des symptômes et de leur signification connaît des divergences radicales si le malade n’est pas prêt à soumettre son interprétation propre de ce qu’il éprouve à celle que lui donne le médecin. La perception des données cénesthésiques est le fait d’un apprentissage social et culturel, elle ne décalque pas en catégories objectives des modifications sensorielles ; même la douleur donne lieu à ces différences d’appréciation (Le Breton, 2010). Plus encore leur origine, si le patient est convaincu d’une cause métaphysique à ses maux. Les usages et les connaissances de la culture médicale échappent au malade, le corps dont il parle est habité par les mouvements de sa vie quotidienne et de ses relations avec les autres, son travail, ses croyances. La pratique médicale s’instaure sur cette différence propice aux malentendus, cet écart entre deux discours d’une égale légitimité, mais de niveaux distincts (Canguilhem, 1966). Elle s’attache, non sans difficulté, parfois avec l’obstacle de la langue, à dissiper par l’interrogatoire les malentendus prodigués par son éloignement du discours profane. En ce sens, tout symptôme, quel qu’il soit, n’apparaît jamais qu’à travers de multiples écrans : son évocation par le médecin ou le patient impose la traduction d’un texte originel jamais donnée en toute objectivité, même si elle peut l’être en toute rigueur. La pratique médicale appelle la prise en compte de la culture mise en jeu par le profane pour dire les souffrances qui le traversent ou les surprises que son corps lui réserve. La bonne volonté apparente du patient n’est pas toujours une garantie, elle fait parfois surestimer ce qui est réellement compris. Ainsi pour une visite de routine avant son retour en Turquie, un patient séropositif reçoit une infirmière et un interprète. On lui avait longuement expliqué la nature de son état et les précautions à prendre. Mais l’interprète, sidéré, découvre que le seul souci de l’homme tient à la pension qu’il s’inquiète de continuer à toucher dans son village. Pour le reste, il avait vaguement compris qu’il avait une «sciatique» ou quelque chose comme ça. Il n’avait rien compris à la dangerosité de son état et au risque de transmission du VIH à son épouse. L’apparente docilité de l’homme avait donné à l’équipe l’impression confortable qu’il avait saisi les enjeux de son état.
L’hôpital, lieu de tension culturelle
En ce qu’il rassemble, du fait de son fonctionnement, des hommes ou des femmes aux multiples origines sociales et culturelles, l’hôpital est un haut lieu de ces divergences de comportements ou de représentations susceptibles d’aboutir à des malentendus entre les soignants et les patients. L’hospitalisation est l’équivalent pour la plupart des individus de l’entrée en une terre étrangère, et marquée de menaces, dont ils ne parlent pas la langue et ignorent les usages. Cette situation de ghetto culturel soulève le souci pour chaque malade d’être reconnu et soigné dans le respect de sa singularité. Le migrant (plus encore sa compagne) incarne sans doute (avec les gens du voyage), la pointe extrême de l’éloignement avec la culture hospitalière, et il est celui qui risque le plus de voir son sentiment d’identité mis à mal par les conditions de l’hospitalisation. Souvent originaire d’un milieu rural et de condition sociale à la limite de la pauvreté, parfois mal intégré par choix ou à cause des vicissitudes de son parcours, le migrant appartient à une culture dominée, il est imprégné de valeurs culturelles différentes de celles les plus courantes du pays d’accueil et il en manie mal la langue. Il est souvent adepte d’une religion qui lui impose des devoirs précis que le contexte hospitalier n’est pas toujours enclin à favoriser. À tort ou à raison, la crainte du racisme alimente parfois une prévention contre le milieu d’accueil. Dans toute relation soignants-migrants s’interpose de part et d’autre un écran de fantasmes plus ou moins favorables, des zones d’ambiguïtés, d’ambivalence dont le soignant est loin d’avoir le monopole, même s’il est en position symbolique d’autorité. Souvent, en effet, le soignant est dans une telle évidence de sa pratique et de ses catégories propres qu’il n’envisage pas un instant que le patient ne réponde sans dilemme aux stéréotypes qu’il projette sur lui. Il surestime alors son degré d’accord aux propositions de traitement. Mais par ailleurs, certains patients échouent à contextualiser leur hospitalisation et les soins reçus et se rebiffent, parfois avec violence. Un certain nombre de faits divers de ces dernières années touchent moins à des malentendus ou à des écarts culturels qu’à une volonté d’imposer une vision des soins ou des examens médicaux. Ce sont surtout les femmes qui en sont les enjeux, quand elles-mêmes ou leur mari refusent des examens ou des soins effectués par des hommes. Pour tenter d’éviter ces débordements, en France, depuis quelques années une charte de la laïcité est placardée dans les couloirs des hôpitaux. Elle rappelle que le patient ne peut choisir son médecin en cas d’urgence, ni imposer ses convictions personnelles avant un soin : « Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène » (Forest, 2009).
Entendre et être entendu
Nombre de malentendus interculturels ont leur source dans ce décalage des attentes mutuelles, liées à la méconnaissance des valeurs fondatrices de l’identité de l’Autre et de l’absence de négociation entre les partenaires de l’échange. Et à l’indifférence envers les représentations profanes qui concernent le corps, la maladie, la douleur, les soins… considérés souvent d’emblée comme des préjugés ou des ignorances. La routine hospitalière en uniformisant les interactions avec les malades produit nombre d’entorses à l’identité du sujet, quelle que soit son origine sociale et culturelle. Elle mobilise ses ressources, ses capacités de s’ajuster à ce qu’il perçoit comme une indifférence coupable, une blessure narcissique ou un outrage (nudité, soins intimes, etc.). Pour ne pas être entamé par une telle situation, il doit contextualiser la situation pour l’accepter provisoirement en sachant qu’il n’est pas chez lui mais immergé dans un espace public régi par un cadre précis qui s’impose à tous. Cette opération symbolique exige notamment une connaissance des ritualités médicales ou une conscience particulière de son impuissance dans la vaste machinerie de l’établissement. Mais le migrant n’est pas toujours enclin à l’un ou l’autre de ces sentiments étrangers à ses familiarités. Une situation mal comprise est parfois vécue comme une agression pure qui suscite une rébellion immédiate. L’indifférence aux origines sociales et culturelles du malade n’est pas une erreur moindre que celle de le réduire à un stéréotype de sa culture ou de sa classe sociale : manière commode et brutale d’élaguer la complexité des choses en un répertoire de prêt-à-penser. Erreurs redoutables et communes nées d’une égale bonne conscience. On ne peut soigner un homme dans l’indifférence ou la violation des valeurs fondatrices qui constituent son existence. Lorsqu’un heurt se produit : le refus d’un diagnostic ou d’un soin par exemple, la solution emprunte la voie d’un échange prenant en compte les raisons de l’objection du patient. La compréhension de son comportement est l’attitude première, sinon rien n’est possible. Des médiateurs (des interprètes par exemple) sont des ressources élémentaires pour remettre du sens et de la réciprocité sur des situations qui paraissent sans issue. Le médecin ou l’infirmière explique alors le niveau de nécessité du soin refusé, ses conséquences… Le malade faisant lui-même part de ses craintes, expliquant son attitude. L’éthique des soins en situation interculturelle n’est pas une question unilatérale, elle implique une sorte de négociation informelle qui laisse au soignant et au malade le sentiment partagé d’avoir été compris. Elle repose sur une mutuelle reconnaissance, une compréhension réciproque, et elle s’appuie parfois sur un compromis, en tout cas sur une argumentation entendue par celui à qui elle s’adresse. Un tel échange confirme l’égale dignité des interlocuteurs ; il est rare alors qu’une solution ne s’impose pas. Quand la communication s’établit sur ce mode, les difficultés s’effacent ou se rétablissent à hauteur d’homme, la parole se délivre sans appréhension, et le motif initial de tension ou d’incompréhension perd de son acuité. La demande de reconnaissance formulée par le patient rencontre un écho auprès de l’équipe soignante, la souffrance ayant trouvé une écoute, souvent le soin est admis sans réserve, ou un aménagement accepté. Si la délibération commune prend la place de l’imposition tout un univers de solutions se présente. À l’inverse, le soignant réagissant avec impatience ou agressivité, ne cherchant pas à comprendre, enkyste la demande implicite du malade d’être pris en considération, fixe des positions d’hostilité difficiles ensuite à modifier. La capacité de modulation personnelle du soignant, l’intuition de la différence de l’autre, amènent à une communication où les appartenances culturelles deviennent secondaires. Le soignant atteint alors la dimension anthropologique du soin, il part du principe que « rien de ce qui est humain ne lui est étranger ». Le malentendu est une proposition pour l’échange, non une fatalité. Si une reconnaissance commune est établie, le malentendu se renverse dans un « bien-entendu », une connivence qui résout d’un trait toutes les difficultés.
Bibliographie
Canguilhem G., Le normal et le pathologique, PUF, Paris, 1966.
Fourest C., La dernière utopie. Menaces sur l’universalisme, Livre de poche, Paris 2009.
Good B., Comment faire de l’anthropologie médicale ?, Synthélabo, Paris, 1999.
Le Breton D., Expériences de la douleur. Entre destruction et renaissance, Métailié, Paris, 2010.