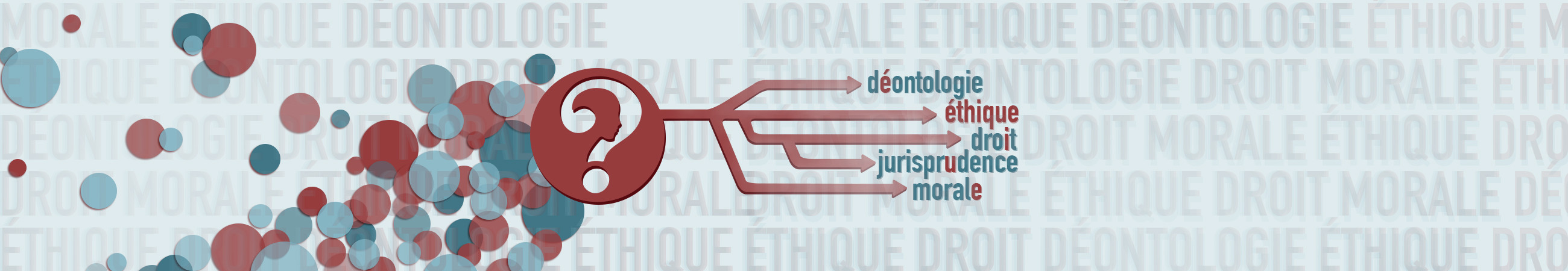Prédispositions génétiques : a-t-on le droit de ne pas vouloir savoir ?
En mai 2013, l’actrice nord-américaine Angelina Jolie révélait avoir eu recours à une double mastectomie préventive après que des tests lui aient appris qu’elle était porteuse de l’altération d’un gène prédisposant au cancer du sein. Aujourd’hui, c’est une Française qui témoigne de son ablation des seins pratiquée en 2007 alors qu’elle n’avait que 26 ans et était porteuse du même type de prédisposition génétique. Dans le but d’éviter ce risque de cancer, les deux femmes ont eu recours à une chirurgie lourde et éprouvante, mais qui représente une prévention réputée efficace, au terme d’un diagnostic génétique rendu possible par les progrès de la connaissance. Savoir leur a donc donné un pouvoir sur la maladie, sur une maladie non encore déclarée. Vivant dans des familles dans lesquelles le poids de cette terrible maladie n’avait pas attendu la puissance des analyses génétiques modernes pour se manifester, ces femmes ont certainement perçu le fait de savoir comme un besoin avant même d’être un droit. Elles l’ont sans doute même perçu comme un devoir au sein, et vis-à-vis de leur famille.
Le poète latin Horace, dans sa lettre à Lollius au premier siècle avant JC, lançait : « Ose savoir ! », ce que l’on peut également traduire par « Ose être sage », une injonction dont Emmanuel Kant fit, en 1784, la devise des Lumières. Le savoir serait-il donc un devoir avant d’être un droit ? Le poète ajoutait : « Pour jouir véritablement de ce qu’on possède, il faut être sain de corps et d’esprit », faisant ainsi un lien entre santé et bonheur. Ce lien est également présent dans la définition que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné de la santé en 1946, et qui est toujours d’actualité : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Bonheur, santé, savoir, voici bien une trilogie qui cherche sa placeà l’heure où les tests génétiques se multiplient et s’affinent, mais aussi un triple champ d’interrogations scientifiques et de questionnement éthique.
Prédispositions génétiques entre savoir médical et savoir profane
Dès le néolithique, l’homme a domestiqué le vivant et commencé à le modifier, en croisant des espèces animales, en modifiant profondément les caractères génétiques des céréales, par exemple. Ce faisant, il touchait du doigt la sélection, et donc la transmission de caractères héréditaires. Pourtant, les historiens nous apprennent que l’hérédité humaine, au sens où nous l’entendons aujourd’hui, est une création relativement récente en biologie. Avant la fin du XVIIIe siècle, les charges et offices seuls relevaient de l’héréditaire, alors que les traits, physiques en particulier, n’étaient pas appréhendés comme tels, bien qu’il fût sans doute déjà de commune expérience que les enfants ressemblent à leurs parents. Il a fallu encore un siècle pour aller de l’hérédité à la génétique, et plus encore pour que des analyses médicales jettent les bases de ce que nous connaissons désormais comme des tests génétiques. En 1963, c’est une prédisposition à une maladie neurologique grave, la phénylcétonurie, qui a pu être détectée grâce au test de Guthrie, le prélèvement d’une petite goutte de sang du nouveau-né sur un papier buvard. Ce test est devenu dépistage systématique, admis d’autant plus facilement dans la société qu’il ouvre sur une prévention simple et efficace de la maladie, un régime alimentaire en l’occurrence.
Dans le domaine du cancer, s’est révélé dans le savoir profane que certaines familles étaient plus touchées par la maladie, et ce savoir n’est parvenu que récemment dans le champ d’expertise de la science et de la médecine. De l’exemple du rétinoblastome (tumeur oculaire de l’enfant) à celui du cancer du sein, ce sont des formes très particulières (et relativement rares) de cancers parfois fréquents qui ont été reconnues comme transmissibles selon des lois simples de la génétique. Pour autant, ces exemples n’épuisent pas tout ce que ce « savoir » profane et quasi instinctif constate dans les familles. La science ne sait pas encore rendre compte de tout le poids que l’hérédité possède, en cancérologie notamment.
Beaucoup d’espoirs se sont ainsi portés vers l’analyse globale du génome (support majeur de notre patrimoine héréditaire), rendue possible par les progrès techniques fulgurants dans le séquençage de l’ADN1. Ne pourrait-on pas grâce à ces analyses globales, reconnaître les stigmates d’une prédisposition à développer telle ou telle tumeur, et anticiper ainsi sur son apparition ? Ne pourrait-on ainsi transformer ces analyses en tests prédictifs, voire préventifs dans le but de se prémunir contre les ravages de la maladie ? Mais le passage de plus en plus rapide de ces analyses de la recherche à la clinique nous interroge sur l’urgence de distinguer entre la validité scientifique d’un test et son utilité clinique. Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), quant à lui, a toujours distingué les analyses diagnostiques qui répondent à une question médicale précise des dépistages plus ou moins systématiques.
Brûlant parfois les étapes, oubliant la question toujours présente de comprendre en quoi notre constitution génétique, cette séquence d’ADN, nous dit quoi que ce soit sur notre santé future, nous assistons à la promotion d’une médecine dite prédictive, fondée sur le génome individuel. Le CCNE a mis en garde contre « Les avancées scientifiques et technologiques [qui] risquent de nous amener à fonder le choix de nos conduites, non pas sur une réflexion éthique, mais sur l’obtention de données générées automatiquement par la mise en place de nouvelles techniques, si elles n’ont été ni prévues, ni planifiées »2. De plus, cette médecine ne nous oblige-t-elle pas à nous considérer comme des malades en puissance puisqu’aucun de nous ne peut oser prétendre à une quelconque normalité génétique ?
Droit ou devoir de savoir
Dans sa quête du savoir, l’homme a toujours entretenu l’ambiguïté entre savoir et certitude, et nombreux sont ceux qui n’interpellent le savoir, et donc la science qui le porte, que dans le but d’effacer le doute et d’accéder à la certitude. Pourtant, Nietzsche n’écrivait-il pas que : « ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou.3 » À cela se mêle le désir, voire le besoin d’anticiper sur le savoir, de le prédire. Les oracles, comme la science, portent des messages complexes, parfois obscurs, dans lesquels l’incertitude est une valeur reconnue. Ainsi que le disait Didier Sicard, évoquant « une génétique divinatoire », « un présent hypertrophié, envahissant s’accompagne d’un futur de plus en plus inquiétant (…), où la recherche est alors sommée de prouver sans inquiéter ». Mais, ce que nous apprennent les tests de prédiction génétique, c’est que le diagnostic biologique posé ne peut en aucun cas être une certitude de survenue de la maladie, même si la présence d’un gène de prédisposition augmente de façon très conséquente le risque de développer un cancer, notamment dans les cas des cancers du sein et de l’ovaire.
Les gènes de prédisposition identifiés sont toujours plus nombreux, et avec eux croît l’offre de tests génétiques qui peut-être « inquiètent sans prouver ». On va même jusqu’à parler de tests « présymptomatiques », terme qui porte en lui une lourde signification de prédestination. Pourtant, même lorsqu’une personne se révèle porteuse d’une mutation, la probabilité qu’elle développe la maladie dépend de beaucoup de facteurs dont peu sont encore connus (on parle de pénétrance de la mutation d’un gène comme mesure de cette probabilité). On peut donc préférer en rester à la notion de test« asymptomatique » qui ne préjuge en rien de l’apparition de symptômes cliniques. Mais, retirer la notion de prédestination de ces tests ne leur enlèverait-il pas alors un peu de leur poids social et de leur valeur marchande ?
Une personne asymptomatique pourrait aujourd’hui avoir accès à un éventail de probabilités de développer les maladies auxquelles elle serait génétiquement le plus vulnérable. Ce qui représente un indéniable progrès en termes de recherche est-il pour autant bénéfique en termes cliniques ? Cette offre de savoir, qui repose sur un désir séculaire d’anticiper l’avenir,développe un besoin, voire une addiction qui peut se révéler anxiogène.
En 2013, le Collège américain de génétique et de génomique médicales (ACMG) a publié des recommandations pour que, en cas d’analyse globale du génome de personnes, notamment celles participant à un projet de recherche, il leur soit rendu compte de données génétiques trouvées secondairement ou incidemment au cours de l’étude. Une liste d’une cinquantaine d’anomalies génétiques devrait constituer une obligation d’information au sujet/patient, que celui-ci en ait manifesté le souhait ou non, et quelque soit son âge. Cette démarche, d’une certaine « agressivité » représente un grand pas vers une obligation de savoir, et donc le renoncement à un droit d’ignorance. Elle était d’autant plus surprenante qu’elle émanait d’un pays où l’autonomie du patient est une dimension majeure de la réflexion éthique, un principe cardinal. L’avis de l’ACMG justifiait en partie le choix de ses options en affirmant qu’une meilleure connaissance de sa propre constitution génétique permettrait d’adapter ses choix de vie en vue d’une santé meilleure. Ainsi se trouve posée la question de savoir si la génomique / médecine prédictive devra créer des devoirs comportementaux en annonçant telle ou telle prédisposition, et quelles en seraient les conséquences, pour les assurances de santé notamment.
En France, la question du droit de ne pas savoir (la volonté d’ignorer telle ou telle, voire même une quelconque prédisposition génétique) ne se pose pas dans les mêmes termes. Pourtant, il existe, depuis la loi du 7 juillet 2011, une obligation d’information de la parentèle en cas de diagnostic d’une maladie génétique héréditaire grave. Mais comment annoncer un risque de maladie à une parentèle qui n’était pas en demande ? Ces questions soulignent le fait que notre patrimoine génétique, la séquence d’ADN qui nous identifie en tant qu’individu, ne nous appartient pas en propre, mais est partagée avec notre famille, que nous l’avons hérité et que nous la transmettons, sans avoir de contrôle sur les éléments que nous transmettons ni sur leur « normalité ».
Droit de savoir et devoir de prévention
Les questionnements qui précèdent montrent la difficulté qu’il y a d’établir un équilibre entre l’autonomie de la personne (et le respect de cette autonomie) et le devoir de solidarité qui s’exprime également dans la mise en garde et la prévention d’un risque ou d’un danger, qu’il soit ou non génétique.
Le Centre d’analyse stratégique, dans sa note d’analyse N° 289 en 2012, remarquait l’absence « d’impact psychologique particulier à la suite du calcul de prédispositions, particulièrement lorsque les tests sont accompagnés de conseils et d’explications ». Mais il soulignait qu’en revanche, ce savoir acquis ne conduit pas à « l’adoption d’un comportement préventif ». Ainsi, la détermination de femmes comme Angelina Jolie face à leur prédisposition au cancer du sein relèverait-elle de l’exceptionnel ? On pourrait le penser alors qu’il demeure, dans notre pays, un nombre impressionnant de fumeurs, et donc de personnes qui, ayant accès à la connaissance bien établie des risques qu’elles prennent de souffrir de maladies terribles, cancéreuses en particulier, décident de ne rien faire de ce savoir. Nous sommes au-delà d’un possible, quoi qu’illusoire droit de ne pas savoir ; nous sommes au cœur d’une ambivalence que ni les progrès de la science et de la médecine, ni l’arrogance avec laquelle ils nous sont présentés, ne semblent pouvoir lever.
Quelques références
- Centre d’analyse stratégique. Note d’analyse n° 289, 2012. Médecine prédictive : les balbutiements d’un concept aux enjeux considérables.
- Paul-Loup Weil-Dubuc. Les servitudes du droit de savoir autour du diagnostic présymptomatique. In laviedesidees.fr, 2013.
- CCNE, avis n° 46 : Génétique et médecine : de la prédiction à la prévention. (Octobre 1995)
- CCNE, Avis n° 120 : Questions éthiques associées au développement des tests génétiques fœtaux sur sang maternel (Avril 2013).