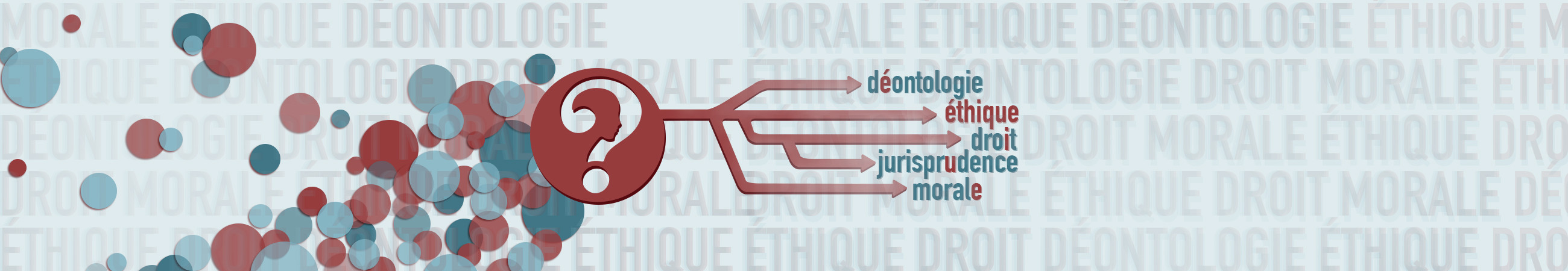Prescription des médicaments onéreux en cancérologie, un impérieux besoin d’éthique
En trente ans, les thérapeutiques innovantes en cancérologie ont apporté de vrais bénéfices pour les malades en termes d’efficacité. Cependant, leur coût peut aller jusqu’à 5 000 euros par mois de traitement. Leur prescription dans le cadre d’une décision médicale de qualité doit alors faire l’objet d’une réflexion rigoureuse à partir de données objectives fondées sur les preuves, l’expérience et la biologie.
La thérapeutique connaît en cancérologie un essor sans précédent : deux médicaments originaux en dix ans dans les années 1980, un médicament original tous les trois mois actuellement. Néanmoins, leur coût est très élevé et menace les équilibres budgétaires. Les médicaments des années 1980 coûtent quelques centimes à quelques euros, tandis que les dernières innovations thérapeutiques ont des coûts variant de 1 500 à 5 000 euros par mois de traitement. Il convient donc de s’interroger sur les conditions d’une bonne décision médicale de prescription d’un médicament antitumoral.
La faculté de médecine n’a pas enseigné les conditions et les enjeux d’une prise de décision. Il en résulte qu’actuellement les étudiants en médecine apprennent en 2e cycle les bases théoriques de la médecine et de la thérapeutique, puis, en 3e cycle, à les mettre en œuvre au lit du malade ; mais c’est durant le clinicat ou lors de l’installation en ville que le médecin se retrouve confronté au malade, aux enjeux de la relation et aux modalités d’une prise de décision.
Le rapport bénéfice-risque est le premier élément à considérer dans la décision qui sera prise. Décision mise en tension entre deux principes éthiques, le principe de bienveillance (« Je vous veux du bien, quelle action sera bonne ? ») et le principe de non-malfaisance (« Je ne veux pas vous nuire, l’action ne risque-t-elle pas d’être néfaste, nuisible ? » « Primum, non nocere »). Pour évaluer ce rapport, il existe trois types de données.
Les données fondées sur des preuves
Il est idéal de disposer de preuves issues des résultats d’études cliniques rigoureuses, mais il est illusoire de fonder l’exercice médical exclusivement sur des preuves. Il existe une infinité de situations cliniques, de nombreuses situations chacune très rares, un nombre croissant d’options thérapeutiques, de sorte que toutes les questions ne peuvent pas faire l’objet d’essais thérapeutiques. Enfin, l’obtention des résultats prend de nombreuses années qu’un patient atteint de cancer peut rarement se permettre d’attendre. Il en résulte que l’on ne peut pas limiter les prescriptions médicales aux situations prouvées au risque d’exclure des patients qui auront simplement « pour défaut » de ne pas correspondre aux situations qui ont été testées. Il n’est pas envisageable de ne pas soigner quelqu’un sur l’argument que la situation n’est pas prévue dans les livres ! Actuellement, peu d’essais cliniques et donc de preuves existent chez les patients de plus de 70 ans. Il serait évidemment aberrant d’en conclure qu’il ne faut pas les soigner.
Encore plus restrictive que la preuve, l’autorisation de mise sur le marché du médicament se limite à une situation très précise. Ne prescrire que dans les situations pour lesquelles un laboratoire a été autorisé de vendre, c’est confondre le champ de la médecine et le champ d’investissement d’un industriel. Il y a des intersections, heureusement, mais également des zones distinctes : un cancer rare ou un cancer fréquent lourdement prétraité ne font pas l’objet d’une grande attention des industriels, car il s’agit de « marchés » trop restreints pour justifier les coûts de développement.
Les données fondées sur l’expérience
Un praticien, confronté un grand nombre de fois à une même situation, en a tiré des enseignements qui lui permettent d’améliorer sa proposition de soins et sa pratique médicale. La limite de cette approche est son manque d’objectivité. Les praticiens, en France, sont encore peu coutumiers d’une analyse rétrospective des résultats de leurs actions pour revisiter la pertinence de leurs décisions et ainsi progressivement les améliorer. Cela nécessite de faire l’effort de créer des procédures de révision des dossiers. Le risque est en effet que son point de vue s’appuie, non plus sur des faits objectifs, mais sur des impressions, des souvenirs. Ceux-ci donnent une large place aux résultats extrêmes (succès inespéré, catastrophe) et rendent plus flous et moins présents à l’esprit les résultats mitigés. Ainsi, les exemples d’essais randomisés contredisant les impressions sont fréquents dans l’histoire de la médecine. Il demeure qu’actuellement nous ne valorisons pas la richesse de l’expérience et ne distinguons pas une décision fondée sur l’expérience, qui pourrait apparaître iconoclaste, d’une décision simplement farfelue. On pourrait admettre que les établissements de santé qui ont une activité de soins « standard » et sans mission de recours et de gestion de cas complexes puissent fonctionner sur la base de référentiels et d’une médecine souvent fondée sur des preuves. En revanche, les centres qui ont une activité de recours, de gestion de la rareté, de la complexité, de la gravité, doivent être autorisés à prescrire hors du champ des preuves. Il en va de l’intérêt des malades, mais aussi des conditions du maintien d’un système offrant les conditions d’une amélioration continue de la qualité et d’un terreau fertile pour l’innovation, car celle-ci se nourrit de l’expérience.
Les données fondées sur la biologie, guidées par la science
Une troisième situation émerge : le cas où l’on peut, à partir d’un test, prédire l’effet du traitement chez un individu donné. Dans ce cas, sous réserve de faire ce test, on peut être fondé à proposer le traitement tandis qu’il n’existe ni preuve ni expérience. Cette situation devrait devenir de plus en plus fréquente au fur et à mesure que des anomalies moléculaires précises au sein des tumeurs prédisent l’effet d’un médicament (amplification de HER 2 et effet du trastuzumab, mutation de k-ras et perte d’effet du cetuximab, etc.).
Ces trois types de données – la preuve, l’expérience et la science – nourrissent l’évaluation médicale du rapport bénéfice-risque et renseigne ce que l’équipe médicale considérera être le meilleur traitement, c’est-à-dire le traitement le plus indiqué face à une situation morbide donnée, donc le traitement le plus performant. Cette prise de décision est améliorée par la mise en place, désormais commune, de réunions de concertation pluridisciplinaires regroupant des experts des méthodes diagnostiques (imagerie, anatomopathologie) et des traitements (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, etc.).
Cependant, le traitement le plus performant n’est pas nécessairement le bon ! En effet, un acte médical n’est un soin que s’il est ressenti comme une aide. Or, cela suppose de confronter la proposition médicale performante à l’égard de la maladie, donc le projet médical, au sens que fait cette proposition pour la personne malade, donc au projet de vie : le médecin est expert de la maladie, le malade est expert de sa vie. Le principe éthique en jeu ici est le principe d’autonomie. Des changements majeurs se sont produits au cours des dernières années, mais la prise en compte de ce principe reste encore largement insuffisante. C’est en effet à l’issue du dialogue médecin-malade que l’on verra si le traitement le plus performant est, ou non, le plus raisonnable.
CONCLUSION
Plutôt que limiter autoritairement et de manière généralisée les prescriptions de médicaments onéreux, il convient, pour faire de vraies économies, de mettre en place les solutions simples suivantes :
– apprendre aux médecins la gestion des émotions, l’annonce de la mauvaise nouvelle et les conditions de l’arrêt des traitements inutiles. Le médecin doit s’interroger sur la proportionnalité des soins ;
– intégrer systématiquement le principe d’autonomie, de sorte que les patients, informés des enjeux et de la réalité du rapport bénéfice-risque, puissent adhérer ou refuser le projet de soins ;
– évaluer précocement l’effet des médicaments prescrits de manière à arrêter le plus tôt possible la prise d’un médicament onéreux inefficace chez un individu donné ;
– définir clairement des centres de référence, de recours, et leur permettre de prescrire hors AMM et hors champ des preuves, dès lors qu’une réunion de concertation pluridisciplinaire a validé la démarche. Actuellement, la Sécurité sociale ne s’engage pas à rembourser à 100 % ces prescriptions.
Ainsi, nous pourrons améliorer la qualité des soins, sans briser l’enthousiasme des médecins, sans priver les malades de l’accès au progrès, sans gaspiller.