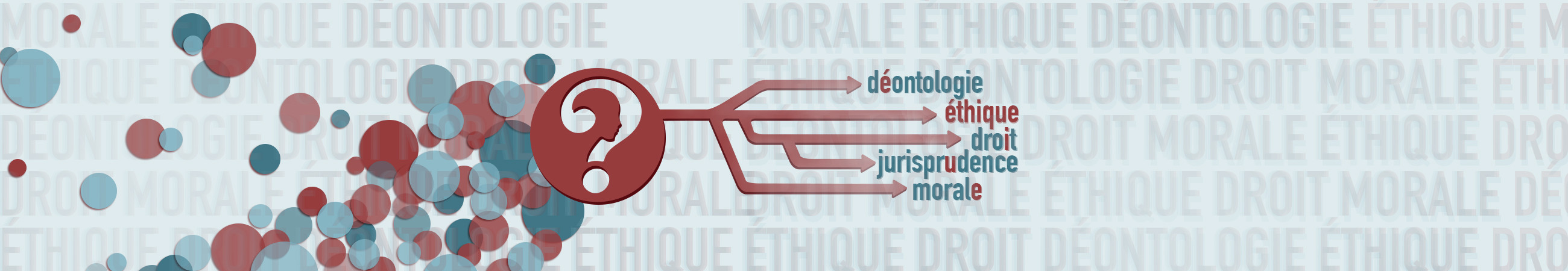Les rapports de la science et de l’éthique sont-ils conflictuels ?
Le but de la science est de s’approcher rationnellement de la vérité des phénomènes de nature et la technique propose de les maîtriser. L’éthique, en revanche, recouvre la réflexion sur ce qu’est «l’action bonne» et les valeurs qui la fondent. Les objectifs de ces deux démarches sont-ils irréductibles les uns aux autres ? Selon la vision optimiste de Socrate et de ses partisans modernes, les progrès exceptionnels des connaissances et des pouvoirs qui lui sont liés devraient avoir consolidé le règne du Bien sur Terre. D’autres postulent aujourd’hui que l’accès au savoir est de nature à bouleverser les fondements moraux de l’éthique. En effet, le lumineux et terrible vingtième siècle, celui du progrès fulgurant de la médecine, de la communication, des sciences de la matière et de l’univers, mais aussi celui de deux guerres mondiales, de trois génocides, de l’arme atomique, de la pollution et du réchauffement climatique n’apparaît pas justifier l’optimisme socratique.
Qu’en sera-t-il pour le siècle présent ? Les nouvelles découvertes et techniques associées poseront à l’évidence de nouveaux défis éthiques. Ceux-ci devront-ils être relevés à l’aide de principes universels et stables, ou bien ces principes eux-mêmes seront-ils remis en cause par les progrès scientifique et technique ?
Rapports complexes et anciens que ceux de la science et de l’éthique… Les relations entre la science, la morale et l’éthique, ont fait l’objet d’intenses débats et de controverses depuis l’essor des premières écoles de philosophie en Grèce dès le VIème siècle avant notre ère. Le terme de sophoï (les savants) ou de physiologues fut appliqué aux premiers philosophes dont l’histoire a gardé le nom : Thalès premier mathématicien, mais aussi Anaximandre et Anaximène de l’école de Milet. L’intérêt de ces philosophes-sophoï se portait non seulement sur l’observation et l’interprétation des phénomènes naturels, mais ils cherchaient aussi à développer des applications pratiques de leurs connaissances tout ceci avec une absence complète de références à une doctrine ou une pensée religieuse. Le développement de cette science née dans l’Ionie antique est étranger à la notion du Bien et du Mal (notre perception moderne de ces concepts est source d’anachronismes).
Les relations entre le Vrai et le Bien occuperont une grande part des travaux des métaphysiciens dans l’Antiquité. Dans une vision très idéaliste, Socrate avançait que seule l’ignorance conduit au mal alors que, à l’inverse, la lumière de la Vérité éclaire le chemin du Bien et évite les égarements mauvais. Protagoras considérait pour sa part que les recherches du Vrai et du Bien sont toutes deux légitimes mais indépendantes l’une de l’autre. Une très grande prudence s’impose néanmoins sur ces thèses car aucun des 12 textes originaux de Protagoras ne nous est parvenu et ce ne sont que des citations par d’autres auteurs qui nous donnent une vision de l’œuvre de ce philosophe. Le philosophe-savant aura une forte proximité avec les institutions officielles religieuses jusqu’au XIVème siècle ; la scolastique en est l’expression avec un enseignement de la vérité scientifique fondé sur la logique déductive mais toujours en accord avec la doctrine religieuse et avec les textes des grands anciens. Les rapports deviendront beaucoup plus conflictuels à la fin du moyen-âge (Giordano Bruno et l’héliocentrisme). Rabelais prendra position sur les relations entre le Vrai et le Bien lorsqu’il déclarera près de vingt siècles après Protagoras dans son œuvre Pantagruel «Sapience n’entre poinct en âme malivole, et science sans conscience n’est que ruine de l’âme».
La science, une quête controversée de la vérité
Le terme de science naît au XVIIème siècle quand s’opère la scission entre les philosophes et les scientifiques. La science a pour but de s’approcher rationnellement de la vérité des phénomènes de nature. Cette séparation s’accompagne d’une volonté forte d’indépendance et d’autonomie comme le montre bien la création des sociétés savantes et leurs devises ; celle de la « Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge » créée en 1660 est Nullius in verba (ne croire personne sur parole). La vérité établie par la démarche scientifique ne s’appuie pas sur l’autorité des textes anciens ou de doctrines, mais elle se fonde uniquement sur l’expérience. Cette séparation s’accompagnera d’une spécialisation dans un domaine de la connaissance : physique, mathématique, chimie… Aujourd’hui, nous sommes à un stade de surspécialisation (physicien des particules par exemple) et la connaissance ou la vision globale de tous les champs de la science par un individu est une utopie.
Éthique et recherche feront alors l’objet de nombreux débats et de vives polémiques dès le XVIIIème siècle et notamment pour la recherche sur l’homme. Rousseau décrit dans Le Contrat social que le « sauvage », individu isolé, devient un individu social et politique par l’aliénation totale de tous ses droits à la société. Selon cette approche, l’homme civilisé social ne possède plus aucun droit ce qui a pu faire dire et écrire à certains que la société possédait les « corps » des êtres humains. La position de Locke est totalement opposée à celle de Rousseau. Pour lui, l’entrée dans la société nous laisse des droits naturels : « L’individu a un pouvoir illimité de disposer de lui-même et de sa propriété». Le droit naturel interdirait de porter atteinte à l’intégrité du corps d’autrui et, en termes plus généraux, à sa vie, sa liberté et sa santé. L’homme a le devoir d’accepter son corps tel qu’il est. Tout sujet est un patient unique insubstituable et ne fait donc pas partie d’une population d’esclaves substituables.
La récente controverse sur l’utilité et l’obligation des vaccinations en France permet de rappeler que le premier débat sur l’expérimentation médicale et l’éthique eut lieu lors de la mise au point par Jenner en 1798 de la vaccination contre la variole. Cette vaccination qui sauva des millions d’individus eut de nombreux détracteurs à l’époque qui avançaient des arguments scientifiques et médicaux : dangers individuels et pour la communauté résultant de l’injection volontaire de pus variolique ou des arguments éthiques ou théologiques (l’homme décide d’aller contre la volonté divine c’est-à-dire contre les voies de la providence). Ce sujet délicat laissa perplexe le grand mathématicien français d’Alembert, précurseur du calcul des probabilités, qui ne prendra pas position dans cette controverse. Kant s’exprimera en 1798 sur la question du consentement de l’homme à être le sujet d’une recherche : « L’homme raisonnable a-t-il le droit de se donner la variole par inoculation, à lui-même et aux autres qui n’ont pas de jugement (les enfants) ou bien est-ce que cette façon de se mettre en péril de mort n’est pas du point de vue moral totalement inadmissible ; sur ce point ce n’est donc pas le médecin tout seul mais aussi le juriste moral qu’il faudrait requérir. »
Mutations, polémiques et tragédies
De profondes mutations ont accompagné la science, la médecine et la biologie durant le XIXème siècle industriel. Se pose alors la question de l’utilité de ces avancées techniques et de leur impact social. À cette époque, l’éthique est confondue avec la « morale » des savants, guidée essentiellement par l’idée de la pureté de la science et les exigences de l’expérimentation. Le scientisme en est la forme extrême conduisant les chercheurs à n’accepter que le jugement des pairs pour le contrôle de leurs activités. Des aphorismes fameux, tel que « Ce qui n’est pas scientifique n’est pas éthique », ont été utilisés et dévoyés par certains courants de pensée pour réduire les relations entre science et éthique. La lecture de l’œuvre de Jules Verne regorge de portraits de bons savants luttant contre des savants dévoyés appliquant à des fins néfastes pour l’humanité les avancées technologiques. Ce siècle industriel verra la reconnaissance internationale de Claude Bernard pour avoir préconisé l’abandon de la médecine empirique au profit des méthodes scientifiques de la médecine expérimentale. Tout le monde connaît ainsi le « Devoir d’essai » mais les considérations éthiques n’étaient pas absentes de sa réflexion d’où le primum non nocere ; ce qui se traduit par la règle suivante « consiste à ne jamais pratiquer sur un homme une expérience qui ne pourrait que lui être nuisible à un degré quelconque, bien que le résultat put intéresser beaucoup la science, c’est-à-dire la santé des autres ».
Les polémiques entre éthique et science vont encore s’accroître avec une acmé dans la deuxième partie du XXème siècle dans les suites de la deuxième guerre mondiale. Le rejet des valeurs humanistes, l’eugénisme et l’euthanasie furent l’œuvre du nazisme. Cette année 2015 est aussi le 70ème anniversaire des tragédies d’Hiroshima et de Nagasaki. Les horreurs et les crimes commis durant la dernière guerre mondiale notamment par les médecins nazis conduiront très rapidement les représentants du corps médical à lancer une réflexion collective. Paradoxalement, c’est en Allemagne qu’avaient été promulguées durant la période de 1931 à 1933 les premières lois biomédicales définissant les conditions dans lesquelles pouvaient être envisagées des recherches.
L’éthique et la loi pour encadrer la recherche
En raison de l’ampleur de la question, je limiterai la suite de cette tribune à la recherche médicale. L’impératif de la recherche médicale est d’améliorer le mieux vivre et le mieux-être des hommes en accroissant sans cesse les connaissances sur la naissance, la vie et la mort. Il convient de veiller à préserver cet objectif final à toute recherche. Tout autre objectif est potentiellement dangereux ; ceci ressort bien de débats qui ont opposé des éthiciens et des législateurs à des chercheurs les accusant de ralentir la recherche dans le sens d’une vitesse de production et de publications. Un des premiers aboutissements des réflexions du corps médical après la seconde guerre mondiale fut la rédaction des grands textes fondateurs sur les principes de la recherche biomédicale, suivie rapidement par l’établissement des codes de conduite déontologique s’appliquant à la recherche clinique. Le débat devint public et plus collectif lors de la préparation des textes de lois encadrant la recherche clinique dans tous les principaux pays occidentaux. Pour la France, la loi du 20 décembre 1988, plus connue sous le nom de « Loi Huriet-Serusclat », est la manifestation de cette réflexion sociétale sur la recherche sur l’être humain. Cette loi a pour fondement la protection des personnes participant à des recherches biomédicales et a déjà connu trois séries d’amendements notables (1998, 2004 et 2006) ; elle sera prochainement modifiée pour prendre en compte le règlement européen du 4 avril 2014. Si le législateur a encadré l’activité de recherche clinique, il n’a pas pour autant délimité et donné des réponses à tous les enjeux éthiques et de société que peuvent poser certaines activités de recherche.
De nos jours, les frontières entre recherche fondamentale et recherche appliquée sont devenues de plus en plus ténues favorisant l’émergence de questions éthiques à des stades précoces. La réflexion éthique qui ne peut être que collective, vu l’impuissance de tout individu à appréhender l’ensemble des connaissances, se doit de traiter du pouvoir des chercheurs et de leur liberté, ou non, d’entreprendre ou non certaines formes de recherches. La question se transforme donc en la définition de critères qui délimitent et encadrent les pouvoirs qu’offrent les nouvelles technologies médicales. L’éthique de la recherche est toujours un délicat exercice d’équilibre entre la liberté d’action du chercheur, l’intérêt scientifique du travail qu’il conduit et l’utilité sociale de ces recherches. On ne peut que se féliciter de la création de l’Espace éthique/APHP/région Île-de-France qui a permis des échanges de très grande qualité dans le cadre de groupes de réflexion pluridisciplinaire s’attaquant entre autres aux enjeux nouveaux posés par les nouvelles technologies médicales. Les lois ne reflètent que la position du corps social via sa représentation démocratique à un moment donné de son histoire.
L’éthique scientifique, une nécessité pour le XXIème siècle
L’éthique et la science seront-elles moins conflictuelles dans la recherche médicale au XXIème siècle ? Il n’est pas possible d’y répondre car prédire les évolutions technologiques à 10 ans est un exercice fort périlleux. Néanmoins deux points méritent d’être évoqués.
Depuis les années 1980, des opérations de médiatisation souvent excessives des « avancées » de la recherche ont été menées avec des effets d’annonce plus que discutables quand ils engendrent de faux espoirs chez les malades et leurs familles. De telles attitudes ne peuvent qu’aboutir à un discrédit des structures employant ces chercheurs et à une attitude de doute sur le futur. Un ancien ministre de la recherche exprimera la même inquiétude : « Les scientifiques qui utilisent les médias pour obtenir des moyens de recherches ou affirmer leur importance rendent un mauvais service à la science et à terme à eux-mêmes ». Rappelons que sur ce point qui relève de l’éthique de l’information, un texte normatif existe déjà au sein du code de déontologie qui prévoit dans son article 14 que « les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical».
Un autre challenge de la recherche clinique est apparu au grand jour vers la fin des années 1990 quand les premiers grands scandales sur la fraude scientifique ont été révélés par les médias ; mêmes médias qui avaient souvent offert leurs plateaux aux communications précoces de chercheurs plus motivés par une reconnaissance personnelle ou par des enjeux financiers. Plusieurs enquêtes et des études sur des bases de données ont révélé que ce phénomène (le « scientific misconduct ») était plus répandu que ce qui était imaginé mais à des degrés divers de gravité. La motivation des fraudeurs n’est pas univoque. L’image du savant ascétique et illuminé investissant tout son temps dans son laboratoire pour l’avancement de la science, a cédé la place à la réalité de la vie économique moderne avec les pressions des financeurs qu’ils s’agissent de start-up de biotechnologie ou de l’État. « Publish or Perish » en est la formule résumée par les Anglo-Saxons. Seule possibilité pour le chercheur de survivre et d’évoluer dans sa carrière dans ce système ? En publiant ! La sortie annuelle du classement de Shanghai du « top 50 » des instituts de recherche est un événement crucial pour le président d’une université. John Maddox, ancien éditeur de Nature, écrivait il y a quelques années que « la communauté scientifique devrait se préoccuper de la fraude, parce qu’elle corrompt la science et mène à la méfiance du public ».
Les objectifs des démarches éthique et scientifique sont-ils par conséquent irréductibles les uns aux autres ? Les médias se font encore parfois l’écho de tenants d’un scientisme débridé, pour lesquels la science est la seule source du progrès, et qui considèrent encore trop souvent comme irrecevables la moindre considération d’ordre éthique. Les débats vont donc se poursuivre entre les lointains successeurs de Socrate et ceux de Protagoras.