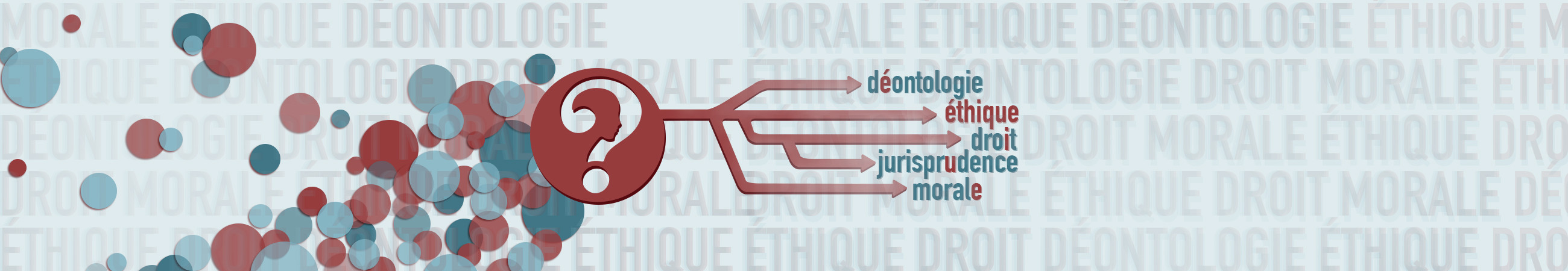Le recours à une « énième ligne de chimiothérapie » pose-t-il une question éthique ?
À la suite de la session extraordinaire tenue par le comité éthique et cancer le 7 octobre dernier au CNIT Paris La Défense, ses membres ont rendu un avis sur la justification de la poursuite d’une chimiothérapie au bénéfice minime voire inexistant lors d’une prise en charge en soins continus. Cette discussion connaît aujourd’hui un prolongement avec l’échange entre Véronique Trillet-Lenoir, présidente du Conseil national de cancérologie, et Axel Kahn, président de l’université Paris-Descartes et président du Comité éthique et cancer.
Véronique Trillet-Lenoir, présidente du Conseil national de cancérologie
« À la phase avancée d’une maladie cancéreuse, lorsque le patient devient réfractaire aux traitements appliqués, se pose le problème de ne considérer les soins que dans un objectif palliatif, en vue de soulager les symptômes ou d’en retarder l’apparition. Cette option peut s’envisager par le recours à de nouvelles molécules anticancéreuses. Leurs effets secondaires sont importants, d’autant que l’état général est souvent déjà altéré par les effets de la maladie et les séquelles des traitements antérieurs. Sauf s’il existe un essai clinique à proposer, l’alternative à ce type de prescription est représentée par une prise en charge globale du patient avec des interventions thérapeutiques à visée symptomatique et de confort, regroupées sous le terme de « soins palliatifs ». La prise de décision médicale se situe ici à la frontière entre l’excès de prescription et la perte de chance, avec la nécessité majeure de prendre en compte les rapports bénéfice/risque et coût/utilité de la stratégie proposée. Elle ne peut se concevoir que dans un cadre pluridisciplinaire et pluriprofessionnel impliquant, entre autres, autour des cancérologues, des spécialistes des soins palliatifs et des soignants non médicaux (infirmières et psychologues en particulier). Leurs interventions seront d’autant plus pertinentes qu’ils auront été intégrés précocement, précisément par anticipation de cette phase, dans la prise en charge du patient. Cette décision impose par ailleurs une discussion la plus sereine et argumentée possible entre le patient, ses proches et son cancérologue, dans le double objectif de rassurer sur l’opportunité de la prise en charge proposée et d’éviter autant que faire se peut le sentiment d’abandon fréquemment décrit. L’ensemble de ce dispositif permet de limiter le risque de recours à des thérapeutiques inutiles, voire nuisibles, et presque toujours coûteuses. Il apporte assistance à la fois au malade et à ses proches, confrontés au caractère inacceptable de la mort, et au praticien face à l’échec professionnel guère mieux admis et à la responsabilité citoyenne vis-à-vis des dépenses collectives de santé, considérée sans indulgence particulière.
Cette situation, qui représente le quotidien des cancérologues médicaux, concernait jusqu’à ces dernières années des malades parvenus à un stade préterminal, dont l’altération de l’état général et des grandes fonctions permettait assez aisément d’anticiper un bénéfice/risque défavorable, les équipes médicales ayant par ailleurs épuisé les ressources thérapeutiques à leur disposition.
Au cours de la dernière décennie, des changements majeurs sont intervenus dans les effets des médicaments anticancéreux avec l’avènement des thérapies dites « ciblées », fruits de l’accélération des connaissances et du flux d’innovations mises sur le marché. Leur variété ainsi que leur efficacité croissante et leur toxicité souvent moindre ont eu comme principales conséquences l’augmentation de la durée de survie et la meilleure qualité de celle-ci avec une nette tendance à la chronicisation d’un certain nombre de tumeurs solides, au premier rang desquelles les cancers du sein.
Par ailleurs, leur fort impact financier préoccupe considérablement les décideurs, très soucieux d’une stricte limitation de leur usage à des indications parfaitement validées. La problématique récemment posée aux professionnels de la cancérologie est représentée par le nombre croissant de patients en très bon état général, peu ou pas symptomatiques, ayant déjà reçu de nombreuses lignes de chimiothérapies et épuisé l’arsenal des traitements validés par les recommandations de bonnes pratiques. Leur demande thérapeutique pour la poursuite de traitements actifs est souvent exprimée de manière insistante, et relayée par les proches. Leur niveau d’information sur les innovations disponibles est rendu élevé par une intense diffusion médiatique. Ces patients n’ont souvent aucun besoin de soins palliatifs ni même de support. La seule réponse médicale adaptée à leur situation est de proposer leur inclusion dans un essai clinique de phase I mais, malgré de récentes avancées, il existe un important décalage entre cette demande et l’offre dans notre pays.
La proposition, la mise en œuvre et le suivi de ces « Nièmes lignes de chimiothérapie » sont lourds d’impacts pour le patient, le praticien et la société. Dans ces situations complexes, les processus décisionnels intègrent des dimensions multiples, médico-scientifiques, socio-économiques, et psychoaffectives. Ils ne peuvent en aucune façon reposer sur la prise de responsabilité d’un prescripteur isolé, et encore moins sur la démarche personnelle d’un patient. Cependant l’expérience prouve que, si la concertation pluridisciplinaire aboutit parfois à une proposition d’interruption des chimiothérapies ou, en tout cas, de pause thérapeutique, la détermination compréhensible des patients à obtenir une proposition de traitement actif les conduit souvent à la remettre en cause, à prendre différents avis et à se ranger à celui qui ira dans le sens d’une intervention médicamenteuse. On assiste ainsi à une évolution de la démarche communément nommée « acharnement thérapeutique », jusqu’ici de déterminisme plutôt médical, et désormais induite par un certain degré de jusqu’au-boutisme des patients et de leurs proches. Et dans ce déni mutuel et tacite de l’insupportable, au sein d’une société consumériste et orpheline de spiritualité, la sollicitation sans limites de la seule technicité médicale risque d’appauvrir, dans sa phase la plus cruciale, l’irremplaçable lien de fraternité entre les patients et les équipes soignantes.
Monsieur le président du Comité éthique et cancer, sommes-nous ici confrontés à une question d’éthique ? »
Axel Kahn, président de l’université Paris-Descartes et président du comité éthique et cancer
« Le Comité éthique et cancer s’est penché de façon répétée, depuis plusieurs années, sur la question de la continuité des soins tout au long de l’évolution d’une maladie cancéreuse ainsi que sur leur adaptation aux différentes phases évolutives. Les traitements administrés peuvent avoir des visées préventives, curatives, frénatrices ou symptomatiques. Un traitement sera considéré symptomatique chaque fois qu’il s’avérera potentiellement actif sur un symptôme ou un ensemble de symptômes sans avoir l’ambition de freiner de manière significative l’évolution de la maladie. Un tel traitement devra, par ailleurs, apporter plus de soulagements qu’il n’entraîne d’effets secondaires. À ce titre, la chimiothérapie et/ou la radiothérapie sont utilisées parfois pour contrecarrer les douleurs, des syndromes compressifs ou d’autres manifestations de cet ordre. De telles thérapeutiques trouvent de la sorte leur place à l’interface entre le stade de plus en plus fréquemment atteint de relative chronicité d’une affection maligne incurable, et les soins palliatifs proprement dits où, en principe, les efforts ne se concentrent plus sur la tumeur elle-même mais sur ses conséquences en termes de confort de vie.
Comme on le voit, une chimiothérapie, quelle qu’elle soit, ne trouve aucune place dans ce schéma si sa seule justification est psychologique alors que, incapable d’entraîner un bénéfice, elle est à l’inverse grevée d’effets secondaires aggravant la condition d’un patient. Cette observation n’induit pas qu’au-delà d’une efficacité authentique des médicaments spécifiques il serait admissible de laisser un malade s’enfoncer dans le désespoir d’une décision d’interruption thérapeutique vécue comme un abandon. Les soins ne doivent connaître aucune discontinuité mais rester en cohérence avec les objectifs poursuivis tout au long de l’évolution du mal. Le dialogue persistant entre la personne malade et l’équipe soignante doit s’efforcer d’apporter au patient des informations authentiques qui lui donnent l’assurance qu’il pourra toujours compter sur ses médecins et leurs aides, que ceux-ci ne feront jamais défection. La qualité de la relation doit les inciter à ne jamais consentir à un geste dont ils connaîtraient le caractère nuisible même si le patient et sa famille le réclament. Un lien de qualité dès la prise en charge de la maladie et la conviction des professionnels qu’il leur revient de maintenir au fil du temps doit permettre d’éviter des attitudes que l’on pourrait considérer empreintes d’une certaine lâcheté.
La question complémentaire posée par le professeur Véronique Trillet-Lenoir, celle de la mise en route d’une « Nième ligne de chimiothérapie » chez un malade pour lequel de nombreux protocoles utilisés auparavant ont maintenant témoigné de leur inefficacité, s’insère dans la réflexion qui précède mais est d’ordre légèrement différent. En effet, en situation d’échec thérapeutique, une « Nième ligne de chimiothérapie », basée sur des produits innovants, peut constituer une thérapeutique efficace, au moins frénatrice et de nature à prolonger une phase de stabilisation menacée par la reprise tumorale. Ici, on se trouve dans des conditions habituelles, soit d’essais thérapeutiques phase I/II, soit de traitement compassionnel, soit encore d’essai d’une association non encore testée dans une situation semblable à celle du patient considéré mais qui a par ailleurs démontré une certaine efficacité. Les critères réglementaires d’une telle inclusion du malade dans un traitement expérimental sont extérieurs à la réflexion éthique. En revanche, tel n’est pas le cas de deux dilemmes de l’ordre de la responsabilité du soignant, vis-à-vis de la personne qu’il se propose d’inclure et vis-à-vis de la société.
En matière d’expérimentation ou de traitement en cours d’évaluation, la règle du consentement libre, express et éclairé est impérative mais sans doute insuffisante : dans la situation où elles se trouvent, les personnes en cause auront le plus souvent tendance à préférer l’action quelles que soient les informations fournies à son propos, à l’abstention. Si bien que la conviction intime de l’équipe soignante, nourrie des données objectives sur le protocole envisagé, est elle aussi un critère important : un geste que l’on hésiterait à accepter pour soi-même où à imposer à ses proches est suspect, même avec le consentement explicite du malade.
Par ailleurs, et c’est là un aspect délicat, il n’est pas facile de faire totalement abstraction du bénéfice coût/avantage escompté du traitement, c’est-à-dire des investissements nécessaires pour une stabilisation brève de l’affection traitée.
Une vive tension se manifeste ici à l’interface de l’éthique individuelle et de la responsabilité sociétale rendue plus aiguë encore par l’irruption des thérapies ciblées de nouvelle génération et par la crise que connaissent nos pays. Il conviendra que le comité éthique et cancer se penche à nouveau sur cette question brûlante. »